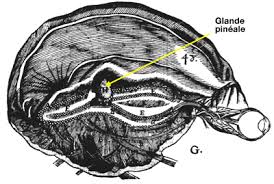Platon est de ces auteurs dont l’autorité parait indiscutable et sur lesquels il semble inconvenant d’exprimer des réserves. Et pourtant : qui peut lire des textes comme « le politique » ou « le sophiste » sans agacement. Platon y met en scène la recherche de l’essence d’un objet (d’une activité humaine) selon une méthode laborieuse que nous allons analyser en détail à partir du passage de 258c à 259c du « Politique » (texte en annexe).
Platon est de ces auteurs dont l’autorité parait indiscutable et sur lesquels il semble inconvenant d’exprimer des réserves. Et pourtant : qui peut lire des textes comme « le politique » ou « le sophiste » sans agacement. Platon y met en scène la recherche de l’essence d’un objet (d’une activité humaine) selon une méthode laborieuse que nous allons analyser en détail à partir du passage de 258c à 259c du « Politique » (texte en annexe).
Platon âgé est pourtant bien le même que celui qui, dans le Menon, faisait dire à Socrate « il n’est pas possible à l’homme de chercher ni ce qu’il sait, ni ce qu’il ne sait pas ; car il ne cherchera point ce qu’il sait parce qu’il le sait et que cela n’a point besoin de recherche, ni ce qu’il ne sait point par la raison qu’il ne sait pas ce qu’il doit chercher », puis rejetait cette aporie en invoquant la science des « prêtres et des prêtresses » et la théorie de la réminiscence. Le voici à présent qui semble avoir tout oublié de ses anciennes théories et qui met en scène un « étranger » et un jeune homme, « Socrate le jeune », encore étudiant, mais sans aucun doute plus avancé que le petit esclave du Menon. L’étranger, citoyen d’une autre cité mais dialecticien non contesté, sait ce qu’il en est de l’essence du « politique ». L’interlocuteur de l’Étranger se dit curieux d’apprendre ce qu’est cette science mais en a nécessairement quelques idées. Nous pensons nous aussi le savoir et nous attendons par conséquent que l’étranger produise son concept, que son interlocuteur le discute et l’affine afin de confronter leurs analyses à ce qui nous aurait paru correct et éventuellement corriger ou enrichir nos idées. Mais il n’en est pas du tout ainsi. Le petit esclave du Menon avait à résoudre un problème de géométrie, et par conséquent à répondre à des questions faisant appel à sa capacité (qui s’avérait tout à fait exceptionnelle), à déduire la solution correcte dans une science dont il ignorait tout. Socrate le jeune, quant à lui, fait face à des alternatives entre lesquelles il doit trancher mais ne devrait pouvoir le faire en bonne logique que pour autant qu’il sait déjà l’essentiel de ce qui est cherché. Empruntant le rôle de l’aveugle que guide le voyant, il se laisse en fait guider là où il sait que son tuteur veut le mener. L’intérêt de cette recherche n’est pas dans ce qui est cherché puisque c’est déjà largement connu, il est dans l’ontologie implicite que suppose la modalité même de la recherche et dans la place que cette ontologie ménage au savoir rationnel, au mythe et à l’analogie car c’est cette ontologie qui justifie la progression laborieuse du dialogue. Aussi nous ne nous attarderons pas sur la distinction entre science pratique et science théorique dont l’élucidation fait l’essentiel du passage. Platon est persuadé que la politique est une science « purement cognitive » : cela peut paraitre curieux mais comment pourrait-il prétendre posséder cette science s’il en était autrement ? Son ambition de mettre le philosophe au pouvoir est à ce prix. Or, il se pense le premier sinon le seul philosophe. Mais, pour l’heure, laissons de côté cet aspect du platonisme même si c’est certainement la clé toute humaine de tout le système !
 Le premier moment de l’analyse commence en 258c. Nous nous concentrerons presque exclusivement sur lui. Sa méthode a déjà été mise en œuvre dans « le sophiste ». Ce qui est fixé seulement en préambule, c’est le nouvel objet de la recherche. Alors que dans « le sophiste », les deux interlocuteurs insistaient sur leur embarras face à la difficulté de la recherche, ils sont ici plus à l’aise. Il s’agit pour eux de faire paraitre leur objet non pas dans le réel, ce qui serait découvrir parmi leur contemporains ou dans le passé un homme éminent qui pourrait être tenu pour le modèle de ce que le politique doit être. Il s’agit plutôt que le concept de politique leur soit complètement intelligible.
Le premier moment de l’analyse commence en 258c. Nous nous concentrerons presque exclusivement sur lui. Sa méthode a déjà été mise en œuvre dans « le sophiste ». Ce qui est fixé seulement en préambule, c’est le nouvel objet de la recherche. Alors que dans « le sophiste », les deux interlocuteurs insistaient sur leur embarras face à la difficulté de la recherche, ils sont ici plus à l’aise. Il s’agit pour eux de faire paraitre leur objet non pas dans le réel, ce qui serait découvrir parmi leur contemporains ou dans le passé un homme éminent qui pourrait être tenu pour le modèle de ce que le politique doit être. Il s’agit plutôt que le concept de politique leur soit complètement intelligible.
La recherche est un cheminement, mais non pas une battue dans un monde où aucune chose n’aurait de lieu assigné. Il s’agit de suivre un « sentier » et donc d’être guidé par une structure déjà présente et apparente. Cette structure est binaire et se répète jusqu’à atteindre « une nature unique ». Il est donc posé a priori que ce qui est cherché possède une réalité (qu’on ne le construit pas), que ce ne peut être qu’une chose simple n’incluant aucune partie. Il est posé aussi que cette chose simple se distingue d’une autre chose également simple mais inverse ou d’une chose pouvant se scinder en parties doubles jusqu’à aboutir à des parties simples opposées à d’autres parties simples du même niveau. Cette conception, propre à l’ontologie platonicienne, lui permet de procéder à un découpage et un classement des choses du monde sans utiliser les catégories d’objet et de propriété. En effet, elle devrait permettre de retrouver et de classer les objets premiers sans en distinguer les propriétés principales (constitutives) et secondaires. (Ceci a déjà été exposé dans notre article du 3 octobre : « le mode de pensée platonicien »)
La recherche est une découverte. Platon le dit expressément : ce que l’on cherche, il faut « le découvrir, et le distinguer des autres ». Il ne pense donc pas créer des concepts mais considère que le concept est déjà là qu’il est à mettre en lumière, à dégager. Il partage en effet ce préjugé dont nous avons dit dans le précédent article qu’il est « fréquent parmi les philosophes » et qui consiste à penser qu’il peut exister quelque chose comme « la politique en soi ».
La méthode est moins extravagante qu’elle le semble d’abord même si elle est terriblement ennuyeuse. Elle suppose effectivement que les deux interlocuteurs savent déjà ce qui est cherché, qu’ils en aient une idée assez claire pour faire le bon choix dans les découpages qu’ils se proposent. Il s’agit d’aller à la chose cherchée par le chemin qui y mène pour bien vérifier qu’elle en occupe le point ultime. Celui qui répond sait donc ce qui est cherché mais le connait moins bien que celui qui l’interroge. Il se laisse guider par lui car ce qu’il a à découvrir ce n’est pas la chose en elle-même mais ce qui en fait « une nature unique ». Le questionné sert le questionneur et lui permet de vérifier qu’il a bien atteint une réalité première, cette « nature unique », en refaisant avec lui le chemin qui y mène, c’est-à-dire en procédant à nouveau et sous son contrôle à l’analyse qui le dégage. Nous avons affaire à une procédure de vérification plutôt qu’à une véritable recherche. L’étranger est dans la situation d’un géomètre expert qui, bien que se sachant expert, n’en demande pas moins à son élève de refaire le raisonnement qu’il a effectué, à la fois pour vérifier ce raisonnement et en communiquer le résultat à son élève. Il aurait pu dicter le théorème démontré à l’élève et lui demander de le tenir pour vrai mais, ce faisant, il ne lui aurait pas permis de devenir lui-même géomètre. Il y a en effet dans cette méthode de division par deux, se répétant jusqu’à ce qu’elle ne soit plus possible, quelque chose comme un procédé de géomètre tirant des diagonales ou comme celui du mathématicien qui ramènerait un nombre à son facteur premier, c’est à dire au nombre premier dont il serait une puissance. C’est pourquoi Platon fait dire à l’étranger que le déroulement du raisonnement et plus encore son premier moment doivent être « l’affaire » de l’élève car celui qui n’aura pas suivi le raisonnement et ne l’aura pas assimilé n’en aurait pas assimilé le produit. Il serait dans la situation de l’élève qui connaitrait le texte du théorème mais ne pourrait guère l’appliquer que mécaniquement puisqu’il ne saurait pas le démonter.
Pour que cette méthode fonctionne, il est implicitement supposé qu’il y a, à la base de chaque chose dotée de réalité, en quelque sorte un seul nombre premier et non une combinaison de puissances de nombres premiers. La chose finale, le concept à découvrir, est toujours nécessairement une chose simple et non une combinaison de choses simples. Ce qui est trouvé n’est jamais complexe dans sa nature : à la manière du triangle qui, comme figure ayant trois côtés, est une chose tellement simple que l’intelligence la conçoit immédiatement : « conception si simple et si distincte qu’aucun doute ne reste » dira Descartes et pourtant chose profonde puisqu’on ne peut pas en épuiser les propriétés.
 Ainsi, pour Platon, les réalités peuvent être composites mais les essences ne le sont pas. Elles sont simples dans le sens où elles peuvent être conçues sans ambiguïté par l’intelligence ce qui ne signifie pas qu’elles ne puissent pas être profondes et difficiles à assimiler et surtout à analyser. Si les essences sont simples, les réalités peuvent être complexes : dans le monde des essences, il n’y a que des choses uniques que l’intelligence peut percevoir directement et sans équivoque pourvu qu’elle se soit hissée à leur hauteur. En revanche, dans la réalité, (en quelque sorte dans la caverne), il y a des choses impures qui participent de plusieurs essences improprement combinées. Il peut même y avoir des choses qui ne correspondent pas à la nature qui devrait être la leur. Dès 259c, le raisonnement vérifie cela puisqu’il amène les protagonistes à dire qu’on peut être roi sans l’être légitimement car on ne possède pas la science royale et qu’on peut à l’inverse posséder la science royale et pouvoir « être légitimement qualifié de roi » sans l’être réellement. Il ne s’agit pas ici de légitimité politique du fait d’une succession ou d’une élection conforme à une constitution. Il s’agit d’une légitimité ontologique. Le roi légitime est celui qui est roi par essence, qui incarne l’essence de la royauté. Toutefois, on ne peut manquer ici de penser aux prétentions politiques contrariées de Platon et à sa tentative malheureuse de faire valoir ce qu’il devait voir comme sa capacité légitime à être lui-même roi : comme son essence royale qui se vérifie par sa connaissance de la science royale (la politique).
Ainsi, pour Platon, les réalités peuvent être composites mais les essences ne le sont pas. Elles sont simples dans le sens où elles peuvent être conçues sans ambiguïté par l’intelligence ce qui ne signifie pas qu’elles ne puissent pas être profondes et difficiles à assimiler et surtout à analyser. Si les essences sont simples, les réalités peuvent être complexes : dans le monde des essences, il n’y a que des choses uniques que l’intelligence peut percevoir directement et sans équivoque pourvu qu’elle se soit hissée à leur hauteur. En revanche, dans la réalité, (en quelque sorte dans la caverne), il y a des choses impures qui participent de plusieurs essences improprement combinées. Il peut même y avoir des choses qui ne correspondent pas à la nature qui devrait être la leur. Dès 259c, le raisonnement vérifie cela puisqu’il amène les protagonistes à dire qu’on peut être roi sans l’être légitimement car on ne possède pas la science royale et qu’on peut à l’inverse posséder la science royale et pouvoir « être légitimement qualifié de roi » sans l’être réellement. Il ne s’agit pas ici de légitimité politique du fait d’une succession ou d’une élection conforme à une constitution. Il s’agit d’une légitimité ontologique. Le roi légitime est celui qui est roi par essence, qui incarne l’essence de la royauté. Toutefois, on ne peut manquer ici de penser aux prétentions politiques contrariées de Platon et à sa tentative malheureuse de faire valoir ce qu’il devait voir comme sa capacité légitime à être lui-même roi : comme son essence royale qui se vérifie par sa connaissance de la science royale (la politique).
Plus profondément l’ontologie platonicienne implique qu’il y ait deux mondes : celui des essences et celui des choses réelles. Elle est un dualisme radical et ne peut manquer de poser le problème de la correspondance de ces deux mondes et de la participation du réel à l’idéel. Car ces deux mondes ne coïncident pas nécessairement et peut-être même ne coïncident-ils exactement jamais. Les choses ne sont jamais complétement et parfaitement ce qu’elles devraient être. Le monde platonicien est de ce point de vue un monde désenchanté c’est-à-dire dont la transcendance est absente parce que projetée dans un au-delà hors de portée du commun des hommes, sinon inaccessible.
L’ontologie qui sous-tend ce qu’écrit Platon implique que la réalité est habituellement corrompue. Une chose peut ne pas coïncider avec son essence. En conséquence, cette essence n’est pas à chercher dans la réalité mais dans la logique des essences. On ne va pas chercher ce qu’est le politique ou le sophiste en dressant des catalogues d’hommes politiques ou de sophistes et en essayant de trouver ce qui leur est commun ou ce qui est excellent chez les uns et moins bon chez les autres. On va chercher ce qu’est le politique ou le sophiste et voir ensuite qui peut, à bon droit et justement, être qualifié ainsi, en sachant qu’il risque de se trouver que personne ne puisse en final prétendre à certaines qualifications et qu’il faudra comme l’a fait Platon dans « la république », proposer une refonte complète des choses pour qu’elles correspondent à ce qu’elles devraient être. L’ontologie qui est ici imaginée justifie la démarche des premières œuvres de Platon où l’interlocuteur de Socrate présente une série d’exemples du « beau » ou de la « vertu ». Socrate lui démontre qu’aucune de ces réalités n’est le beau ou la vertu en elle-même, que l’essence de la chose est ailleurs, qu’en conséquence il ne connait pas ce qu’il prétend connaitre mais n’en connait que des avatars toujours incomplets et illusoires. Si Socrate détruit ainsi les illusions de ses contemporains, ce n’est pas qu’il se plait à les humilier, mais c’est plutôt qu’il veut leur faire comprendre que leur savoir n’est que la connaissance de choses imparfaites. Ainsi, Menon, qui enseigne la vertu, sait sans aucun doute beaucoup de choses de toutes les formes d’excellence auxquelles ses élèves peuvent aspirer, mais il n’est pas en mesure de concevoir le concept de vertu comme une chose simple et distincte directement et complètement intelligible. Socrate ne le peut pas plus que lui. Il sait qu’il ne sait rien, c’est-à-dire qu’il a conscience de ne pas avoir contemplé les essences. Il s’en remet « aux prêtres et aux prêtresses ». Il y a un saut, effectué par Platon, dans la substitution de l’étranger à Socrate. Le Platon qui met en scène l’étranger est certain de posséder un savoir. Il ne se soucie plus de démontrer l’ignorance de l’autre : son but est de lui faire partager son savoir. L’interlocuteur est un élève et non un adversaire. La dialectique est toujours là mais elle n’est plus agonistique mais est une dialectique d’analyse.
Comme l’objet de la recherche est un concept, celle-ci va donc commencer par une chose très générale dont la compréhension se donne facilement. Cette chose très générale dégagée d’abord n’est pas et ne peut pas être un concept puisqu’au moment où la recherche s’engage, les interlocuteurs n’ont rien épuré des réalités qu’ils manient. Il s’agit au contraire de voir que la chose n’est pas « unique » mais qu’elle se présente comme un « ensemble » et que cet ensemble « se répartit en deux espèces ». Il faut donc que les interlocuteurs se placent dans la situation où ils n’en restent plus à constatation qu’il y a une multitude de sciences mais où cette multitude fait apparaître un ordre : qu’elle se scinde en deux groupes, sans aucun reste. D’emblée l’analyse contraint à quitter le niveau du simple constat pour saisir et voir quelque chose de fondamental. Cette chose c’est que les sciences sont un domaine spécifique se divisant en deux. Il en est ainsi des sciences parce qu’il en est ainsi de toutes choses. La dualité des choses est une réalité ontologique. C’est la forme essentielle du monde des essences. On peut imaginer qu’elle est une projection inconsciente du découpage de l’humanité en masculin et féminin et de toute forme vivante en mâle et femelle.
 Cette dualité ressort d’une constitution du monde qui devrait permettre d’atteindre toute réalité simple, pourvu qu’on parte d’un point qui y mène et qu’on procède aux césures qui conviennent. Mais trouver la césure n’est pas chose aisée. C’est comme trouver la parallèle qu’il faut tirer pour démontrer que la somme des angles du triangle est égale à l’angle plat. C’est pourquoi l’étranger ne demande pas à Socrate le jeune, d’être un nouvel Euclide mais de faire l’effort de comprendre la césure proposée. Il lui demande de faire que son « âme conçoive que l’ensemble des sciences se répartit en deux espèces » comme il lui demanderait de voir la symétrie d’une figure. Ce à quoi Socrate le jeune résiste tout d’abord pour convenir ensuite que c’est bien son affaire. Il se met dans la disposition de l’élève qui a compris que le professeur fait appel à sa capacité à appliquer les théorèmes qu’il connait déjà à la figure qui apparait après que la parallèle à la base du triangle a été tirée. L’étranger guide alors son interlocuteur à l’aide d’exemples jusqu’à ce qu’il conçoive clairement que les sciences se divisent en sciences cognitives et sciences pratiques. Les quelques exemples qui sont proposés n’épuisent pas l’ensemble des sciences et c’est donc par une conversion de son intelligence que Socrate le jeune voit clairement que cette césure épuise la totalité du domaine des sciences et que nécessairement toute science devra se ranger dans l’une ou l’autre espèce : « que ce sont là les deux espèces d’une seule et même chose, la science considérée dans son ensemble ». Il en a la compréhension immédiate et complète de telle sorte qu’il ne cherche pas s’il pourrait se trouver une science qui ne soit d’aucune des deux sortes.
Cette dualité ressort d’une constitution du monde qui devrait permettre d’atteindre toute réalité simple, pourvu qu’on parte d’un point qui y mène et qu’on procède aux césures qui conviennent. Mais trouver la césure n’est pas chose aisée. C’est comme trouver la parallèle qu’il faut tirer pour démontrer que la somme des angles du triangle est égale à l’angle plat. C’est pourquoi l’étranger ne demande pas à Socrate le jeune, d’être un nouvel Euclide mais de faire l’effort de comprendre la césure proposée. Il lui demande de faire que son « âme conçoive que l’ensemble des sciences se répartit en deux espèces » comme il lui demanderait de voir la symétrie d’une figure. Ce à quoi Socrate le jeune résiste tout d’abord pour convenir ensuite que c’est bien son affaire. Il se met dans la disposition de l’élève qui a compris que le professeur fait appel à sa capacité à appliquer les théorèmes qu’il connait déjà à la figure qui apparait après que la parallèle à la base du triangle a été tirée. L’étranger guide alors son interlocuteur à l’aide d’exemples jusqu’à ce qu’il conçoive clairement que les sciences se divisent en sciences cognitives et sciences pratiques. Les quelques exemples qui sont proposés n’épuisent pas l’ensemble des sciences et c’est donc par une conversion de son intelligence que Socrate le jeune voit clairement que cette césure épuise la totalité du domaine des sciences et que nécessairement toute science devra se ranger dans l’une ou l’autre espèce : « que ce sont là les deux espèces d’une seule et même chose, la science considérée dans son ensemble ». Il en a la compréhension immédiate et complète de telle sorte qu’il ne cherche pas s’il pourrait se trouver une science qui ne soit d’aucune des deux sortes.
On pourrait s’étonner que l’analyse commence par cette compréhension de la dualité du domaine de la science puisqu’il semblait s’agir d’abord de savoir qu’est le politique. Mais trouver la science du politique et trouver ce qui est l’essence du politique, c’est mettre en œuvre le même procédé pour arriver à un seul et même point. Ce qui diffère ce n’est pas le point d’arrivée, la nature simple qu’on atteint, mais le point de départ. Quand on cherche la science du politique, on part de la science en général, c’est-à-dire du lieu où commence cette science, on part du porteur non encore discriminé d’une science elle-même non encore discriminée. On peut d’ailleurs faire remarquer que puisqu’on se situe dans le domaine des essences, le politique en tant qu’individu n’existe pas. L’homme politique, le politicien, est du domaine du réel et ne peut qu’incarner plus ou moins imparfaitement l’essence du politique comme concept. Passer du politique comme homme à la politique comme science, ce n’est pas substituer une problématique à une autre, c’est passer d’un niveau ontologique (celui du réel) à un autre (celui des essences). Ce qui est tout l’objet des échanges entre l’étranger et Socrate le jeune.
Si l’étranger ne fait pas répondre Socrate le jeune après la phrase « Alors le politique, allons-nous le considérer comme un roi, un maître (…) ou bien dirons-nous qu’il y a autant de techniques que nous avons prononcé de noms ? » c’est tout simplement que répondre à cette question serait contredire l’idée exprimée par ailleurs qu’on peut être légitimement roi sans l’être. On peut en conséquence être roi tout en exerçant une autre forme d’autorité, comme, selon Platon, on peut être médecin sans exercer la médecine si on a le savoir permettant de conseiller le médecin. Si personne n’est roi par essence, même pas celui qui est au pouvoir parce qu’il a été élu ou l’est par sa naissance, il n’y a pas, dans le monde réel, de science royale que posséderaient par expérience les rois accomplissant correctement leur charge. La science royale est une notion qui appartient au monde des essences. Elle n’est pas la technique de tel ou tel roi, encore moins celle de tout roi. Elle est ce qui fait l’essence de la royauté et lui confère sa légitimité ontologique. Elle appartient au roi qui est ontologiquement roi et non au roi parce que le destin l’a fait roi, c’est-à-dire accidentellement selon le point de vue de Platon. Platon n’identifie donc pas le politique au roi, et la politique à la science royale. Le roi appartient au monde réel, la politique comme essence dégagée par sa recherche appartient au domaine des essences. Elle est du domaine du transcendant. Le roi participe plus ou moins à l’essence du politique. Il y a sans aucun doute dans le choix de l’expression « science royale », un choix politique sous-jacent mais il n’est pas pensé comme tel. Il s’agit de désigner le point de convergence de deux réalités : le concept de politique et la réalité de celui qui est le dépositaire ou le participant dans le réel de cette idéalité. Si celui qui exerce le pouvoir est appelé roi, ce n’est pas qu’il soit nécessairement roi du point de vue constitutionnel, mais qu’il l’est par sa participation pleine et entière à l’essence du « politique » comme Idée.
On voit que par sa structure même, la philosophie de Platon est fortement normative. Se disant connaissance des essences, elle peut s’autoriser à dire ce qui doit être. Elle est une façon de se donner idéalement un pouvoir auquel, semble-t-il, Platon n’a jamais cessé d’aspirer sans pouvoir l’atteindre. Elle réalise dans le ciel des idées, ce qu’il ne pouvait pas faire sur terre. Elle le fait Législateur pouvant seul légitimement doter la cité d’une Constitution parfaite et souverain ou tyran légitime là où le destin aurait pu lui permettre de régner. Le dogmatisme de sa méthode d’investigation est la copie du dogmatisme des vues politiques qui la sous-tendent.
Voici le passage analysé :
« L’Étranger : De quel côté va-t-on trouver ce sentier qui mène vers la politique ? Il faut en effet le découvrir, et le distinguer des autres, en marquant qu’il ressortit à une nature unique et en indiquant que tous les sentiers qui s’en écartent ressortissent à une seule autre espèce, faire ainsi que notre âme conçoive que l’ensemble des sciences se répartit en deux espèces.
Socrate le jeune : Cela, Étranger, c’est désormais ton affaire, et non la mienne.
L’Étranger Pourtant, il faut bien qu’elle soit aussi la tienne, quand nous l’aurons éclaircie.
Socrate le jeune : Tu as raison
L’Étranger : Eh bien, l’arithmétique et certaines autres techniques qui lui sont apparentées ne sont-elles pas séparées de la pratique, ne se bornent-elles pas à fournir une connaissance ?
Socrate le jeune : C’est le cas.
L’Étranger : Alors que la technique du charpentier et celle de tout autre travailleur manuel sont dépositaires d’une science qui, pour ainsi dire, appartient naturellement aux actions auxquelles elles apportent leurs concours afin qu’adviennent ces corps qui n’existaient pas auparavant.
Socrate le jeune : Sans conteste.
L’Étranger : Divise alors l’ensemble des sciences de la façon que voici, en donnant aux unes le nom de « pratiques » et aux autres celui de « purement cognitives ».
Socrate le jeune : Je t’accorde que ce sont là les deux espèces d’une seule et même chose, la science considérée dans son ensemble.
L’Étranger : Alors le politique, allons-nous le considérer comme un roi, un maître d’esclaves ou encore l’administrateur d’un domaine, dans l’idée que tous ces noms font référence à une seule et même chose, ou bien dirons-nous qu’il y a autant de techniques que nous avons prononcé de noms ? Mais suis-moi plutôt dans la direction que voici.
Socrate le jeune : Laquelle ?
L’Étranger : Celle-ci. Suppose que quelqu’un qui n’est pas un spécialiste soit en mesure de donner des conseils à un médecin public, ne devra-t-on pas, en vertu de sa technique, lui donner le même nom que celui qu’on réserve à celui à qui il prodigue ses conseils ?
Socrate le jeune : Oui.
L’Étranger : Mais quoi ? Ne dirons-nous pas que celui qui est de taille à donner des conseils à un homme qui règne sur des contrées, même si lui-même n’est pas un spécialiste, possède la science dont le dirigeant devrait être lui-même le dépositaire ?
Socrate le jeune : C’est ce que nous dirons.
L’Étranger : Mais n’est-il pas certain que la science que possède le roi véritable est la science royale ?
Socrate le jeune : Oui.
L’Étranger : Et celui qui possèdera cette science, qu’il se trouve être au pouvoir ou qu’il soit un simple particulier, ne sera-t-il pas toujours qualifié légitimement de « roi » en vertu même de sa technique ?
Socrate le jeune : Oui, ce serait juste.
L’Étranger : Et il en ira de même pour l’administrateur d’un domaine et pour le maître d’esclaves ?
Socrate le jeune : Sans contredit.
L’Étranger : Et quoi ! entre l’étendue d’un domaine d’un côté et la masse d’une petite cité de l’autre, y aura-t-il une différence en ce qui concerne l’exercice de l’autorité ?
Socrate le jeune : Aucune.
L’Étranger : Il est donc manifeste, pour répondre à la question qui nous occupe à la question qui nous occupe à présent, que tout cela se rapporte à une science unique. Et si quelqu’un veut dire de cette science qu’elle est la science royale, la science politique ou la science économique, nous ne nous opposerons aucunement à lui.
Socrate le jeune : Pourquoi en effet en irait-il autrement ? »
 Quand on entre, comme moi, dans le cinquième ou sixième âge, on a le sommeil léger. Ainsi, l’autre nuit, j’avais l’esprit qui vagabondait. Je pensais à une longue et difficile dissertation sur le problème de la « vérité » que j’avais lue la veille.
Quand on entre, comme moi, dans le cinquième ou sixième âge, on a le sommeil léger. Ainsi, l’autre nuit, j’avais l’esprit qui vagabondait. Je pensais à une longue et difficile dissertation sur le problème de la « vérité » que j’avais lue la veille. Après m’être levé le matin je descends dans la salle à manger et je regarde l’heure sur la pendule. Je connais donc l’heure (par exemple 8h00) : je suis capable d’expliquer pourquoi je crois qu’il est 8h – donc j’ai une croyance justifiée – car je peux dire que mon horloge fonctionne, qu’elle m’a toujours donné la bonne heure, etc. Mais, en réalité, cette horloge s’est arrêtée tout à fait par hasard sur 8h (par exemple la veille quand il était 20h) et je ne m’en suis pas aperçu. Ainsi, s’il est véritablement 8h, on ne peut pas dire que je le sais parce que ma justification se base sur des éléments faux, et ce n’est que par chance que j’ai eu raison (si j’étais arrivé trente minutes plus tard, alors la proposition « il est 8h » aurait été fausse).
Après m’être levé le matin je descends dans la salle à manger et je regarde l’heure sur la pendule. Je connais donc l’heure (par exemple 8h00) : je suis capable d’expliquer pourquoi je crois qu’il est 8h – donc j’ai une croyance justifiée – car je peux dire que mon horloge fonctionne, qu’elle m’a toujours donné la bonne heure, etc. Mais, en réalité, cette horloge s’est arrêtée tout à fait par hasard sur 8h (par exemple la veille quand il était 20h) et je ne m’en suis pas aperçu. Ainsi, s’il est véritablement 8h, on ne peut pas dire que je le sais parce que ma justification se base sur des éléments faux, et ce n’est que par chance que j’ai eu raison (si j’étais arrivé trente minutes plus tard, alors la proposition « il est 8h » aurait été fausse).