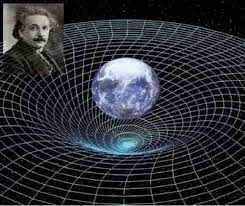On aurait pu me faire cette objection : comment pouvez-vous dire à la fois que le temps et l’espace n’existent pas et qu’une chose existe quand elle peut être située dans le temps et l’espace ? Comment ce qui existe pourrait-il se manifester dans ce qui n’existe pas ?
On aurait pu me faire cette objection : comment pouvez-vous dire à la fois que le temps et l’espace n’existent pas et qu’une chose existe quand elle peut être située dans le temps et l’espace ? Comment ce qui existe pourrait-il se manifester dans ce qui n’existe pas ?
A cela je peux répondre que le nombre douze n’existe pas (dans le sens que j’ai donné à ce mot) mais qu’il n’en est pas moins vrai qu’un cube a douze arêtes. C’est que le nombre douze a une réalité. Il est le produit de l’acte de dénombrer. Les nombres ont une réalité et font l’objet d’usages inépuisables. Pour ce qui concerne le temps et l’espace, il nous est plus difficile de comprendre cela car nous sommes trompés par notre usage ordinaire du langage. Quand nous situons une chose dans l’espace, nous la situons non pas dans un espace absolu mais par rapport à une référence elle-même spatiale que nous omettons le plus souvent d’indiquer car elle va de soi pour l’interlocuteur. Nous indiquons la droite ou la gauche en fonction d’une direction donnée, de même pour le nord et le sud ou le haut et le bas. Pourtant, tout cela conduit à des difficultés qui donnent le tournis. Pour les affronter, je me fais aider de mon collègue Einstein et de son interprète le physicien russe Landau.
Ils me ménagent et commencent par des observations simples : ainsi, nous sommes si habitués à pouvoir dire que deux événements ont eu lieu au même endroit que nous donnons à cette formule une signification absolue. Or, elle est dénuée de sens. Pour le vérifier, imaginons que deux copines conviennent de se retrouver dans le wagon restaurant du Paris-Nice pour écrire à leur mari qu’elles vont au carnaval. Les maris ne diront pas que les lettres viennent du même endroit si l’une a été postée à Lyon et l’autre à Valence. Pourtant les deux copines diront que les lettres viennent du wagon restaurant du Paris-Nice. Personne n’a tort dans cette affaire.
C’est la même chose, si nous disons que deux étoiles de la voûte céleste coïncident. Il faut spécifier que l’observation est faite de la terre. On ne peut parler de la coïncidence de deux événements dans l’espace que lorsque qu’est indiqué le lieu où on se situe.
Conclusion : la notion d’espace est relative. Si on veut situer un corps dans l’espace, il faut spécifier sa position par rapport à d’autres corps. Et si on nous demande de situer un corps sans mentionner d’autres corps, la question est absurde.
 Si la position d’un corps dans l’espace est relative, il s’ensuit que son déplacement l’est aussi (puisque le déplacement n’est rien d’autre que le changement de position). Si on observe le mouvement d’un corps de deux observatoires différents, ce mouvement apparaitra différent. C’est un phénomène qu’en fait nous connaissons tous : un objet est largué d’un avion, pour le pilote il tombe en ligne droite ; pour un observateur au sol, il décrit une courbe. (A cela s’ajoute souvent pour l’observateur au sol que l’objet est une bombe, mais c’est une autre histoire).
Si la position d’un corps dans l’espace est relative, il s’ensuit que son déplacement l’est aussi (puisque le déplacement n’est rien d’autre que le changement de position). Si on observe le mouvement d’un corps de deux observatoires différents, ce mouvement apparaitra différent. C’est un phénomène qu’en fait nous connaissons tous : un objet est largué d’un avion, pour le pilote il tombe en ligne droite ; pour un observateur au sol, il décrit une courbe. (A cela s’ajoute souvent pour l’observateur au sol que l’objet est une bombe, mais c’est une autre histoire).
La forme géométrique que décrit un corps en mouvement est tout aussi relative qu’une photographie. Photographier une maison de face ou du ciel ne donne pas le même cliché, filmer la chute d’une bombe de l’avion ou du sol ne donne pas les mêmes images. Les documentaires sur les guerres le prouvent.
Il ne faudrait pas en conclure que tous les points de vue se valent. Un bon photographe choisit l’angle qui lui donnera le meilleur cadrage. Dans l’espace ce qui importe le plus souvent, c’est de pouvoir prédire la forme que prendra la trajectoire et donc de pouvoir connaître les lois qui régissent le mouvement. De ce point de vue toutes les positions d’observation ne se valent pas.
Saurez-vous répondre à cette question : quelle est la meilleure position ? debout ou couché ? La meilleure position est évidemment la position « couché ». C’est la position de repos, celle d’un corps sur lequel aucune force ne s’exerce. (Ceux ou celles qui ont pensé à autre chose auront fait la bonne réponse pour de mauvaises raisons).
Mais comment réaliser un tel état ? La réponse déconcerte : pour qu’un corps soit au repos, il faut le transporter le plus loin possible de tous les corps afin que ceux-ci ne puissent exercer aucune action sur lui. On va me dire : bon ! on n’y est pas rendu !
Mais si ! Avec un peu d’imagination c’est facile. Nous allons observer les propriétés du mouvement en nous situant par la pensée dans un tel lieu. Dès lors que les propriétés d’un mouvement observé à partir d’un lieu quelconque se distinguent de celles constatées à partir d’un corps en repos, nous saurons que nous nous situons dans un lieu en mouvement. Puisque nous avons établi que les lois du mouvement ne sont pas les mêmes selon qu’on se situe dans un lieu en mouvement et dans un lieu en repos, nous pouvons éliminer la relativité du mouvement. Fini le tangage et le mal de mer, chaque fois que nous parlerons du mouvement, il s’agira du déplacement par rapport à l’état de repos.
Prenons donc le train. Embarquons-nous à bord d’un train qui roule à une vitesse constante sur une voie droite. Observons les objets dans le compartiment : nous voyons qu’ils se comportent comme quand le train est à l’arrêt. Si on lance une balle à la verticale, elle nous retombe dans les mains.
Il en va autrement si le train freine ou accélère ou si le train modifie sa direction. D’où nous tirons cette importance conclusion : tant qu’un lieu d’observation, « un laboratoire », se meut uniformément et en ligne droite par rapport à un laboratoire au repos, il est impossible d’y déceler le moindre écart dans le comportement des corps par rapport à celui que l’on observe dans un laboratoire au repos. Autrement dit l’état de repos et l’état de mouvement rectiligne et uniforme ne se distinguent en rien. Mais il y a une infinité d’états de mouvement rectiligne et uniforme. En fait, il n’y a donc pas d’état de repos mais une multitude infinie d’états de repos. L’état de repos n’est pas absolu mais relatif et, du coup, il n’y a pas de mouvement absolu. Tout est de plus en plus relatif.
On ne peut pas parler de mouvement rectiligne et uniforme d’un corps doté d’une certaine vitesse sans spécifier le laboratoire au repos par rapport auquel on mesure cette vitesse. La vitesse se révèle donc aussi relative (puisqu’elle dépend de la vitesse propre du laboratoire d’observation). En choisissant pour référence différents laboratoires au repos, on obtient de résultats différents. Par contre les modifications de la vitesse (accélération, ralentissement) seront les mêmes. Elles ne dépendent pas du laboratoire au repos choisi et sont donc absolues.
Tout cela est bien compliqué, pourtant une lumière pourrait bien en jaillir.
 Mon collègue Einstein me rappelle que la terre tourne autour du soleil à la vitesse de trente kilomètres à la seconde. Cela pourrait expliquer pourquoi je suis toujours décoiffé. Mais voilà qu’il m’apprend aussi que je suis bombardé par des projectiles capables de se déplacer à la vitesse de trois cent mille kilomètres à la seconde. Mais c’est sans problème, heureusement, car cette vitesse est celle de la lumière dans le vide. Cette vitesse est constante. Dans un milieu homogène, on ne peut ni l’accélérer ni la ralentir. Si on fait traverser une paroi de verre par un rayon lumineux, il retrouvera à la sortie la vitesse qu’il avait avant.
Mon collègue Einstein me rappelle que la terre tourne autour du soleil à la vitesse de trente kilomètres à la seconde. Cela pourrait expliquer pourquoi je suis toujours décoiffé. Mais voilà qu’il m’apprend aussi que je suis bombardé par des projectiles capables de se déplacer à la vitesse de trois cent mille kilomètres à la seconde. Mais c’est sans problème, heureusement, car cette vitesse est celle de la lumière dans le vide. Cette vitesse est constante. Dans un milieu homogène, on ne peut ni l’accélérer ni la ralentir. Si on fait traverser une paroi de verre par un rayon lumineux, il retrouvera à la sortie la vitesse qu’il avait avant.
Les conséquences de cela sont un peu perturbantes et finissent de me décoiffer. Imaginons qu’on tire une balle de fusil dans un train en marche (svp contentons-nous de l’imaginer) : qu’on tire dans le sens du mouvement du train ou dans le sens inverse, la vitesse de la balle par rapport aux parois du wagon sera toujours la même. Mais qu’on allume une lumière dans le wagon de tête ou dans le wagon de queue d’un train se déplaçant à 240.000 Km/s, il en sera autrement. La vitesse de la lumière étant, à ce qu’on nous dit, constante et de 300.000 Km/s, sa vitesse de propagation devrait être dans un sens de 60.000 Km/s et dans l’autre de 540.000 Km/s. Dans un train en mouvement, la lumière devrait donc se propager à des vitesses différentes suivant le sens de cette propagation tandis que dans un train immobile cette vitesse sera la même dans les deux sens.
Pour vérifier cela sans avoir à construire un train ultra rapide, il faut se rappeler que nous sommes sur un bolide se déplaçant à 30 km/s. Il est donc possible de mesurer la vitesse effective de la lumière sur terre selon qu’elle aille dans le sens du déplacement de la terre ou en sens inverse. Cette mesure fut réalisée par Michelson en 1881 et il constata que la vitesse que la lumière se comporte exactement comme la balle de fusil. Sa vitesse est la même dans toutes les directions.
La valeur d’une vitesse doit être différente pour deux laboratoires se déplaçant l’un par rapport à l’autre (la vitesse, comme le mouvement, est relative). Pourtant, la vitesse de la lumière (300.000 Km/s) est toujours la même pour tous les laboratoires. Il s’en suit qu’elle n’est pas relative. Elle est absolue. C’est l’idée qu’elle était relative qui autorisait le raisonnement qui disait qu’on mesurerait des vitesses différentes dans le train selon le sens de propagation. Or ce raisonnement s’avère faux.
Y a un problème, il faut que je reprenne ce train.
 Me voilà de retour dans le train. C’est un train long de 5.400.000 km qui roule, en ligne droite et uniformément à la vitesse de 240.000 km/s. Montez-y avec moi si vous voulez suivre. Cette fois une ampoule s’allume au milieu du train. Quand la lumière arrive au bout du train (en tête et en queue), elle ouvre la porte du wagon. La lumière met 9 secondes (2.700.000/ 300.000) pour atteindre les extrémités du train et les deux portes s’ouvrent en même temps.
Me voilà de retour dans le train. C’est un train long de 5.400.000 km qui roule, en ligne droite et uniformément à la vitesse de 240.000 km/s. Montez-y avec moi si vous voulez suivre. Cette fois une ampoule s’allume au milieu du train. Quand la lumière arrive au bout du train (en tête et en queue), elle ouvre la porte du wagon. La lumière met 9 secondes (2.700.000/ 300.000) pour atteindre les extrémités du train et les deux portes s’ouvrent en même temps.
Un observateur est situé sur le quai et voit passer le train. Par rapport à la gare, la lumière se propage également à la vitesse de 300.000 Kms/s. Comme le wagon de queue se déplace à la rencontre des rayons lumineux, la lumière l’atteint après 2.700.000/(300.000+240.000) = 5 secondes. Mais, dans l’autre sens, la lumière poursuit le wagon de tête et ne le rattrape qu’au bout de 2.700.000/(300.000-240.000) = 45 secondes. Il y a un écart de 40 secondes entre l’ouverture des portes.
Donc les mêmes événements sont simultanés vus du train et espacés de 40 secondes vus du quai. C’est comme si on venait nous dire qu’une girafe est plus longue de la queue à la tête que de la tête à la queue. Et pourtant c’est bien ce qui arrive : le temps, comme l’espace, comme le mouvement, est relatif.
La notion de simultanéité devient relative et n’a de sens que si on précise le mouvement du laboratoire dans lequel les événements sont observés.
La vitesse de propagation d’un phénomène d’un point à un autre de l’espace ne peut dépasser la vitesse de la lumière. C’est une loi de la nature que la théorie de la relativité démontre. Il s’ensuit de grandes difficultés, mais qui ne remettent pas en cause ma définition du temps. Elles la confirment plutôt. Le rapport entre les mouvements est parfois surprenant, ce n’est toujours qu’un rapport entre mouvements qui sont relatifs à l’exception de celui de la lumière qui est absolu car elle est la vitesse limite de toute propagation.
Les conséquences de tout cela sont vertigineuses : ainsi toute horloge en déplacement retarde sur les horloges à l’état de repos. Tout observateur immobile par rapport à sa montre voit les autres montres avancer tant qu’elles se meuvent par rapport à lui, et d’autant plus que leur vitesse est grande. Nous pouvons aussi avoir un objet qui se contracte ou s’allonge pour deux observateurs en situation différente sans d’aucun des deux soit dans l’erreur. Je ne suis pas capable de démontrer tout cela mais je renvoie le lecteur à l’article d’Einstein sur la relativité restreinte et je lui souhaite bonne lecture.