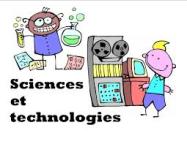Une société est une communauté humaine solidaire, organisée autour d’institutions communes (économiques, politiques, juridiques, etc.) dans le cadre d’une civilisation à un moment historique défini. Cette communauté regroupe non pas directement des individus mais des groupes unis par des liens familiaux et des relations de parenté réelle ou fictive par lesquels les individus s’identifient.
Une société est une communauté humaine solidaire, organisée autour d’institutions communes (économiques, politiques, juridiques, etc.) dans le cadre d’une civilisation à un moment historique défini. Cette communauté regroupe non pas directement des individus mais des groupes unis par des liens familiaux et des relations de parenté réelle ou fictive par lesquels les individus s’identifient.
Partant de cette définition nous pouvons développer, dans une première partie, la base conceptuelle d’un marxisme actualisé, puis en seconde partie, nous pouvons l’appliquer à la société et au capitalisme contemporain, pour en déduire, dans une troisième partie, les grands axes des luttes sociales et politiques qui devraient s’imposer au 21ème siècle .
*
Toute société est organisée en vue d’assurer sa pérennité par la production et la reproduction et se structure selon deux axes qui sont le rapport social de sexe et le rapport social de production.
- Autour du rapport social de sexe se construit la vie commune mais aussi l’opposition des hommes et des femmes qui se reconnaissent comme à la fois différents et complémentaires par leur rôle dans la mise au monde puis l’éducation de leur descendance. Chaque individu est appelé à se rattacher à l’un des groupes, à s’en approprier les valeurs (valence différentielle), et doit apprendre à modeler son comportement selon qu’il est reconnu de sexe masculin ou de sexe féminin.
- Le rapport social de production organise les groupes occupant un rôle distinct dans la production des biens, leur distribution, leur consommation. Les groupes ainsi distingués s’appellent des classes sociales. Elles ont en commun d’être productives. Selon le degré de développement des sociétés ce peut être les chasseurs, cultivateurs, éleveurs, commerçants, transporteurs, apprêteurs – bouchers – boulangers etc.). S’ajoutent à ces classes productives les classes non productives (souvent qualifiées de moyennes) qui assurent des rôles d’organisation et de direction, de transmission, d’élaboration des…savoirs.
Rapport social : Un rapport social peut se définir (selon la sociologue Danièle Kergoat) comme une contradiction, une relation antagonique, une tension qui scinde et fonde une société en groupes qui prennent conscience d’eux-mêmes, de leur place et de leurs intérêts réciproques et antagoniques à partir de leur vécu et en le dépassant. Danièle Kergoat exprime ainsi ce dépassement : « Les relations sociales sont immanentes aux individus concrets entre lesquelles elles apparaissent. Les rapports sociaux sont, eux, abstraits et opposent des groupes sociaux autour d’un enjeu » (ex. la domination d’un sexe sur l’autre). Les relations sociales sont donc des interactions de personne à personne. Les rapports sociaux sont des liens institutionnalisés et idéologisés de groupe à groupe (entre les sexes ou entre les classes). Pour que la société soit stable les rapports sociaux doivent être régulés par des institutions stabilisatrices.
Les institutions stabilisatrices : Les deux rapports sociaux fondamentaux, de sexe et de production sont stabilisés et pérennisés par des institutions qui sont de ce fait les plus fondamentales dans toute société car elles en assurent la stabilité. Ces deux institutions sont la famille (le système familial) et le régime de propriété.
- Les systèmes familiaux : Pour le rapport social de sexe l’institution stabilisatrice est la famille. Son importance fondamentale a été mise en évidence par les travaux d’Emmanuel TODD. Elle assure la stabilité dans le temps de la société, son renouvellement continu. Elle modèle l’ensemble de la société, de ses institutions politiques à la culture commune. C’est dans et par la famille que chacun se voit assigné son identité sociale (nom et prénoms) ainsi que sa place dans la succession des générations (ascendants et collatéraux), ceci principalement selon son sexe.
- Les régimes de propriété : le partage des fruits du travail et des ressources naturelles, de ce qui peut ou ne peut pas être l’objet d’une appropriation, ne se fait pas de la même façon dans toutes les sociétés. Dans la société esclavagiste l’homme peut être objet de propriété. Dans la société féodale la propriété se pense comme un droit de domination et de possession dans le cadre de relations de vassalité et de suzeraineté. Dans la société bourgeoise elle est considérée comme un droit naturel de possession exclusive sur les biens acquis de façon reconnue légitime. Dans la société capitaliste le capitaliste est propriétaire des fruits du travail de ceux qu’il emploie. La possession collective se développe dans les sociétés modernes pour permettre la maitrise des sources d’énergie et des réseaux de transport. La question de la propriété et des institutions qui l’organisent sont, à toutes les époques, au centre des luttes politiques.
L’État : L’ensemble institutionnel est scellé et organisé, harmonisé, et assuré dans sa perpétuation par une institution régulatrice : l’État. Souvent l’Etat s’appuie sur les croyances collectives proposées par les religions et les grandes idéologies. C’est à travers ces croyances collectives appuyées sur une histoire commune, une unité de territoire et de langue et une unité économique que la société devient Nation.
La dynamique des institutions stabilisatrices : C’est la libération des conditions de vie permise par le développement des forces productives associée à la dissolution des croyances collectives qui a permis l’ébranlement des systèmes familiaux et la grande amélioration contemporaine de la condition féminine (comme le montre l’ouvrage de Vera Nikolski « Féminicène »).
Comme l’a montré Marx, c’est le développement des forces productives qui est le principal moteur de l’ébranlement du régime de propriété. Alors, d‘organe de régulation l’Etat se mue en instrument de possession collective et donc d’évolution du régime de propriété quand s’amorce le passage historique du mode production capitaliste au mode de production socialiste. Ce processus est actuellement en cours. Il amorce un passage au socialisme selon des modalités nouvelles (à la chinoise).
Engels s’est intéressé à l’apparition de cet ensemble institutionnel fondamental dans « l’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État »
Les temporalités : A l’échelle de l’histoire, l’évolution des rapports de production et de sexes se fait selon des temporalités différentes. Le rapport de production évolue rapidement et par sauts sous l’impulsion des forces productives tandis que le rapport social de sexe et les systèmes familiaux semblent figés puis se modifient soudain pour s’ajuster au rapport de production et à son régime de propriété.
Les normes : La norme, qu’elle soit pensée comme religieuse, morale ou juridique, est dès l’origine au cœur des rapports sociaux de sexe et de production. La norme est inséparable des rapports sociaux. Elle est ainsi inhérente à l’essence humaine. L’interdit et son envers le droit sont constitutifs de l’humanité et des droits fondamentaux que l’homme se proclame. C’est dans les rapports sociaux propres à l’humanité que les droits de l’homme et les droits fondamentaux trouvent leur fondement
Si nous exprimons cette évolution en termes marxistes, nous pouvons distinguer différents niveaux : — la superstructure constituée, en particulier du système législatif, — l’idéologie dont la fonction est d’assurer l’homogénéité sociale (conscience de classe et pensée dominante), — la morale ou les morales et religions qui répondent pour chacun au besoin de non-contradiction avec soi-même. Nous avons enfin l’infrastructure composée des rapports de production, de la forme de propriété et des institutions qui leur sont liées et qui structurent les rapports sociaux. Marx dit que c’est l’infrastructure qui est l’élément moteur de l’ensemble social. C’est le développement des forces productives qui, par des médiations complexes, impulse l’évolution du corps social.
On voit bien cependant que la superstructure ne réagit pas mécaniquement aux mouvements de l’infrastructure. Les religions, les idéologies ont une forme d’évolution plus vaste que celle des forces productives. Et l’on croit avoir réfuté Marx en faisant cette observation. Mais c’est oublier l’élément essentiel qui fait le ciment de la société : le code culturel.
Le code culturel : le passage de l’infrastructure à la superstructure se fait avant tout par le biais du code culturel. Une couche sociale nouvelle apparait, (par exemple la bourgeoisie de robe dans l’ancien régime, la classe des travailleurs intellectuels dans la société contemporaine). Cette couche sociale nouvelle, qui vit quelque chose de nouveau au niveau de son rapport à la base matérielle de la société, fait évoluer le code culturel de l’ensemble social. L’ancien code subsistant souvent sous une forme « zombie » dans une partie de la société. Cela donne les Lumières pour l’ancien régime et la libéralisation des mœurs, la diversification des modes de vie, pour la période contemporaine, le catholicisme ou le nazisme zombies (Todd – Chapoutot). Le système législatif et l’idéologie s’adaptent à cette réalité nouvelle. La société évolue et le code culturel fonctionne comme son point nodal, comme la glande pinéale dans la représentation cartésienne de l’être humain. C’est par lui que se fait le lien entre infrastructure et superstructure.
La cohérence interne de l’infrastructure, quant à elle, est assurée par la parenté des modes de pensée que requièrent ses différents domaines (droit, philosophie, art, religion). Ces domaines doivent s’adapter au nouveau code culturel. Ils connaissent ainsi des périodes d’équilibre et des périodes d’inadéquation et de crise. Pour illustrer une période d’équilibre, on peut citer le travail de Erwin Panofsky : Selon cet auteur, au 12ème siècle, architecture gothique et pensée scolastique ont évolué de concert car les architectes de la grande époque gothique se sont armés des instruments intellectuels qu’ils devaient à la scolastique. D’où des homologies structurales entre la cathédrale et une œuvre comme la Somme théologique de Thomas d’Aquin
Lorsque l’équilibre entre infrastructure et superstructure est bouleversé, comme avec l’apparition de la bourgeoise de robe, ou pour la période contemporaine avec l’essor rapide du classe de travailleurs des sciences et des techniques, le code culturel se modifie et met sous tension le régime de propriété et le système familial. Se manifestent des résistances mais toujours un domaine de l’infrastructure s’adapte et modifie son mode de pensée pour légitimer de nouvelles valeurs. La philosophie souvent connait un renouvellement, l’art et le droit suivent. La religion finit par être entraînée. Un nouvel équilibre s’installe.
Le hors norme : Ainsi, dans toutes les sociétés il se trouve des groupes et des individus qui ne trouvent pas leur place. Pour le rapport social de production ils forment le « lumpenprolétariat » sous ses différentes formes (misérables, sans domicile, ou délinquants, mafieux etc.). Pour le rapport social de sexe il s’agit de tous les individus qui ne peuvent assumer leur sexe. Les groupes ainsi formés sont l’objet d’étude des idéologies dites « études de genre » qui les regroupent sous le sigle LGBTQI+. Le rôle politique de ces milieux LGBT très actifs est sans commune mesure avec leur importance numérique car leur idéologie est relayée par les institutions dans tout l’occident depuis les grandes universités des USA. Mais cette idéologie ne résiste pas à la critique marxiste si celle-ci s’appuie sur les concepts matérialistes et historiques de rapports sociaux (de sexe et de production) et d’institutions stabilisatrices (systèmes familiaux et régime de propriété).
La théorie du genre est philosophiquement idéaliste et anhistorique en ce qu’elle combat une domination universelle anhistorique « le patriarcat » et qu’elle refuse ce qu’elle appelle, selon les termes du manuel « introduction aux études sur le genre », les « visions essentialistes de la différence des sexes » et qu’elle substitue ainsi le discours (la construction) au réel en s’appuyant sur quatre affirmations : « le genre est une construction sociale; le genre est un processus relationnel; le genre est un rapport de pouvoir; le genre est imbriqué dans d’autres rapports de pouvoir » pour arriver à soutenir que « le sexe peut être analysé comme le produit du genre, comme le résultat d’un système de division qui renforce continuellement sa pertinence en donnant à voir les sexes comme les éléments naturels et pré-sociaux constitutifs du monde dans lequel nous vivons ». La théorie du genre dénie ainsi la capacité humaine à accéder au réel et brouille le concept de « rapport social ». Alors que pour le marxisme les rapports sociaux se fondent sur des différences réelles telle que la différence des sexes avec ce que cela induit dans la mise au monde et l’éducation des enfants, ou sur le rôle producteur ou consommateur, et qu’ils se constituent et organisent la société autour des enjeux vitaux et universels que sont la production et la reproduction, la théorie du genre qualifie de « rapport social » toute forme de domination entre groupes sociaux. A un triptyque de base (genre/race/classe) elle joint des rapports de sexualité, d’âge et de handicap. Ce qui la conduit à théoriser leur consubstantialité ou leur intersectionnalité dans le cadre d’une société kaléidoscopique faite de groupes et sous groupes pris dans des relations de domination et de fusion. Tout cela aboutit à effacer le réel pour lui substituer le discours dans la lignée des philosophies post-modernes et particulièrement de Michel Foucault. L’idéologie du genre a cette négation du réel en commun avec le néo-libéralisme (pensons à cette affirmation bien connue de Margaret Thatcher : « There is no such thing as society »). Selon E. TODD, ce déni de la réalité (sexuel aussi bien que politique) est la forme achevée du nihilisme du monde occidental.
Le concept de rapport, dialectique et essence humaine: Le concept de rapport tel que nous l’avons utilisé ici fait référence au mode de penser dialectique. Penser une dialectique telle que celle de l’évolution des sociétés humaines, c’est penser en termes de devenir, de rapport et de système. Le rapport premier étant la contradiction (moteur de l’auto dynamisme des systèmes) (1).
De même, dire « l’essence humaine n’est pas une abstraction inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, elle est l’ensemble des rapports sociaux. » c’est dire que l’humain ne peut se comprendre que dans un cadre social dynamique assurant la production et la reproduction avec ses institutions premières (système familial et mode de propriété) et dans son historicité (la réalité humaine c’est l’histoire). Cette affirmation est au fondement de l’anthropologie marxiste.
Aux rapports sociaux s’ajoute et se combine le rapport de l’homme au monde. Georg Lukäs parle ici de « reflètement » (wierderspiegelung). Ce rapport se déploie dans le cours de l’humanisation entre quotidienneté, religion, art et science.
Cela fait du concept de rapport le socle de l’édifice conceptuel du marxiste. C’est pourquoi nous avons commencé par lui pour en arriver à notre réalité présente : la société capitaliste et ses rapports sociaux conflictuels. Le but étant d’en déduire les axes de lutte sociale que cette réalité conflictuelle impose au 21ème siècle.
**
les modes de production : Les classes sociales productives ont un statut différent selon le mode de production auquel a accédé la société, en fonction de son développement économique généré par le progrès de ses forces productives. Les producteurs peuvent ainsi être esclaves, serfs, ou hommes libres dans les sociétés qui n’ont pas encore accédé au machinisme. Ils peuvent être artisans ou ouvriers (loueurs d’ouvrage ou salariés) dans les sociétés disposant d’outils simples. Ils peuvent être indépendants ou en coopérative ou encore sous la dépendance de ceux qui dépossèdent les moyens de production. A des moyens de production différents correspondent des modes de production et des classes dominées ou dominantes différents. Il y a cependant une constante à tout mode production, c’est la nécessité d’assurer sa stabilité et celle de sa structure de classes.
Le mode de production capitaliste : Les différentes situations institutionnelles permettent de distinguer les modes de production. Spécifier quel est le mode de production d’une société c’est indiquer son régime de propriété et comment y sont combinés les facteurs de production du fait de leur niveau de développement. Le facteur de production premier étant le travail humain dont le renouvellement doit être assuré par un système familial adapté.
La particularité du mode de production capitaliste sous lequel nous vivons actuellement c’est qu’il produit de façon industrielle des biens, qui sont la propriété du capitaliste, pour un marché sur lequel la marchandise a une valeur d’échange qui est fonction du travail socialement nécessaire incorporé. La valeur de la marchandise est exprimée sous une forme monétaire modifiée par des situations comme le développement inégal ou la publicité.
Le mode de production capitaliste se développe en phases successives. Permis par une phase d’accumulation du capital marchand ou esclavagiste, et stimulé par une mutation intellectuelle favorable à l’innovation il apparait sous sa forme manufacturière, puis dans sa forme classique avec machinisme et une maitrise de l’énergie mécanique (machine à vapeur). Il prend sa forme développée avec les réseaux électriques et les énergies fossiles. Il est dans sa phase ultime avec l’impérialisme et la globalisation.
L’appropriation capitaliste est possible car la force de travail est alors elle-même une marchandise que le capitaliste achète sur le « marché du travail » et dont la valeur est exprimée sous forme monétaire comme salaire. Dans le mode de production capitaliste le surplus social a une nature particulière : il prend la forme d’un profit, d’un capital qui s’accumule et est accaparé par la classe capitaliste propriétaire des moyens de production. C’est cette appropriation qui est appelée « exploitation capitaliste ». Elle a pour « secret » le fait que le travailleur, dans le temps qu’il travaille, produit plus de valeur qu’il n’en coûte, qu’il produit un surplus social dont il est dépossédé.
Dans les sociétés développées le surplus social est l’expression actualisée et médiatisée par la monnaie, de la plus-value ou survaleur générée par le travail productif. Il prend des formes différentes selon les sociétés, les civilisations et les époques. Il se dissout en progrès de la civilisation quand il prend la forme de productions artistiques comme en Égypte ancienne. Dans les sociétés développées il fait partiellement retour au producteur car il permet le financement des systèmes de santé, de l’éducation, de la culture, et des moyens de transports etc. Mais il peut aussi être dilapidé en construction d’apparat comme des pyramides ou des châteaux, dans des festivités et de la vie de cour et leurs équivalents modernes. Il est accaparé aussi par le capital financier sous forme de capitaux spéculatifs et est alors amassé dans des « paradis fiscaux ».
Les sociétés complexes : L’activité d’une société complexe ne se réduit pas à la production et à la reproduction. Sa structure ne se limite donc pas aux sexes et aux classes. Peuvent s’y ajouter d’autres groupes comme des castes ou des ordres (noblesse, clergé) des groupes plus ou moins stables comme les gens de guerre ou les intellectuels. L’ensemble classes, castes, groupes est en constante évolution et se modifie sous l’impulsion du développement des forces productives qui passent de l’outil manuel à la machine mue par l’énergie éolienne ou hydraulique des moulins, à la machine à vapeur puis au moteur à explosion et à l’électricité, de la force musculaire humaine et animale, du vent et de l’eau courante à la combustion du bois et du charbon, puis aux énergies fossiles pétrole et gaz, puis à l’énergie nucléaire et aux énergies renouvelables – ces dernières énergies pouvant être transportées sous forme d’électricité). Ces différentes formes d’énergie se cumulent plutôt qu’elles se remplacent.
Les différents composants de la structure sociale interagissent entre eux pour former un système c’est-à-dire une unité complexe dotée d’un mouvement propre résultant des interrelations entre ses différents éléments. Ce mouvement, qui peut-être continu et progressif ou connaitre des sauts évolutifs soudains, des révolutions, affecte les deux grands rapports sociaux – en premier lieu le rapport de production, puis principalement avec l’industrialisation le rapport social de sexe. Dans le cadre de ce mouvement de fond, de cette « tectonique », des classes ou des groupes apparaissent et cherchent leur place, d’autres régressent et perdent leur influence.
La classe montante : C’est le développement des forces productives qui est le moteur des changements institutionnels. Ainsi dans les sociétés modernes, capitalistes ou socialistes, la classe de la petite paysannerie régresse en nombre et en influence tandis que la classe des ingénieurs et techniciens mettant en œuvre les technologies de l’information, des communications, des réseaux, de la robotique et de l’intelligence artificielle croissent en nombre et en influence. J’appelle classe montante, cette classe mettant en œuvre ces nouveaux moyens de production. Dés-lors que les forces productives se développent, que des innovations les modifient, il apparait une classe nouvelle qui les met en œuvre. Cette classe lutte pour être reconnue et recevoir sa part de son travail.
Universalité des conflits de classe : Tout rapport met en relation deux termes complémentaires qui s’opposent. Le rapport social de production est donc un rapport polarisé. Dans le cadre du mode de production capitaliste, il oppose prolétariat et bourgeoise. Le prolétariat et la bourgeoise ne sont pas à proprement parler des classes sociales mais des pôles du rapport social de production dans le cadre du mode de production capitaliste. A chacun de ces pôles se regroupent des classes qui trouvent leur répondant au pôle opposé. Les capitalistes capitaines d’industrie emploient la classe des ouvriers d’industrie. La classe des propriétaires fonciers trouve son complément dans celle des fermiers qui travaillent ses terres, etc. Ces classes, occupant des pôles opposés, sont en lutte pour le partage des fruits du travail et pour le pouvoir politique (pour le partage du surplus social et pour faire évoluer l’institution fondamentale qu’est la propriété). Elles défendent leur position ou s’efforcent de s’imposer si elles sont montantes. Dans cette lutte, qui fait l’histoire des sociétés, elles s’organisent politiquement et cherchent à s’allier.
Une société sans classes ? Quand on parle de société sans classe, il ne s’agit évidemment pas, dans un avenir prévisible, de voir disparaitre la distinction entre les travailleurs de l’industrie ou des champs, ou avec des travailleurs des autres secteurs comme les mines, les transports ou la distribution. Il s’agit d’en finir avec la domination bourgeoise sur les classes productives et de voir disparaitre la polarisation du rapport de production par la disparition de son pôle bourgeois. Cela est possible dans la mesure où la bourgeoisie possède les moyens de production et en tire profit mais en délègue la mise en œuvre à une classe managériale qui lui est rattachée. Car la propriété privée des moyens de production n’est pas une condition de leur mise en œuvre mais le plus souvent un obstacle : elle règle l’allocation des ressources (les investissements) non en fonction des besoins mais selon leur profitabilité. Elle accumule des actifs financiers (des créances sur la production) au lieu de les investir productivement.
La nature des moyens de production : Les moyens de production ont une double nature : ils sont matériels mais aussi immatériels. Ils incorporent des biens issus du travail productif antérieur comme des machines, les installations, des sources d’énergie. Mais ils sont aussi immatériels et consistent alors en savoir : sciences, techniques, expériences, organisation raisonnée etc. Il y a donc, dans les sociétés, deux types de classes sociales productives: celles qui mettent principalement en œuvre les instruments de la production et celles qui mettent en œuvre les savoirs pour développer ces moyens de production et en améliorer l’efficacité. Cela n’est en rien une nouveauté : l’apparition de l’agriculture et de l’élevage a vu, à l’aube de la civilisation, se développer les classes des cultivateurs et des éleveurs. L’invention de l’écriture a permis l’apparition de la classe des scribes. Ces classes se sont disputées le surplus social et ont lutté pour le pouvoir. Elles se sont, dans cette lutte, dotées d’institutions sociales adaptées et ont développé un monde d’idées et de représentations.
La modernité a vu l’apparition de formes d’énergie impropres à l’appropriation privée (donc inadaptées au régime de propriété bourgeois). L’électricité et l’atome nécessitent des investissements gigantesques à la rentabilité lointaine. Ces énergies exigent une gestion planifiée et centralisée et d’importantes normes de sécurité. Elles se déploient à travers des réseaux qui couvrent un pays entier. Ces énergies s’accordent mal avec la gestion capitaliste qui exige une rentabilité rapide. Elles imposent de fait une gestion socialiste. (2)
Les industries du numérique vont encore plus loin. Elles connectent le monde entier et ne connaissent aucune frontière. Elles exigent un déploiement matériel rapidement obsolète toujours plus important, leur consommation électrique est gigantesque, leur consommation minière est insoutenable, elles mobilisent en conséquence d’importants capitaux fixes. Leur rentabilité directe est donc faible. Elles ne génèrent d’énormes profits financiers et sont des sources de pouvoir que par le biais d’une obsolescence rapide des matériels et, pour leur partie immatérielle, par la perception de recettes publicitaires, par la vente des données qu’elles collectent et vendent. Elles se trouvent de ce fait au centre des luttes politiques modernes. Ces industries numériques sont animées par une classe sociale nouvelle aux caractéristiques particulières. Cette classe qui met en œuvre les nouveaux moyens de production matériels et immatériels de la révolution scientifique et technique, que j’ai définie comme la classe montante, est composée principalement des travailleurs de la science. Cette nouvelle classe montante est internationalisée dans sa partie la plus qualifiée (cela se constate dans l’usage presque exclusif de l’anglo-américain comme langue de travail). Son influence sur nos sociétés est énorme.
Les modalités de la lutte des classes au 21ème : Dans ces processus de développement des forces productives, caractérisées par le passage d’une source d’énergie à une autre plus puissante, les hommes sont les agents de processus qui les dépassent. Avec le machinisme c’est la classe des ouvriers loueurs d’ouvrage des ateliers et des manufacture qui domine. Sa partie la plus active est proudhonienne ou anarchosyndicaliste. Avec le charbon et le pétrole et l’essor de la grande industrie, la classe la plus puissante au pôle prolétarien est celle des mineurs de fond, des ouvriers d’usine, des chemins de fer et des ports. Son avant-garde s’exprime par la deuxième internationale, puis, stimulée par l’exemple de la révolution russe, par la troisième internationale. Le passage à des formes plus scientifiques encore d’énergie, pétrole, électricité et atome, accompagné d’une désindustrialisation des pays d’Europe et des USA, voit le communisme de la troisième internationale décliner. Une nouvelle classe montante apparait et avec elle des idéologies nouvelles encore confuses.
La domination du capital (des classes bourgeoises) sur la nouvelle classe sociale des sciences et des techniques, se heurte à la nature particulière de la richesse que crée cette classe montante. En effet, cette classe sociale, pour sa partie « software », ne produit pas des marchandises mais directement des produits directement consommables et des moyens de production dont elle fait commerce sous forme de service ou de droit d’usage. Il y a certes une lutte pour le partage des fruits du travail qui vaut autant pour les fruits du travail intellectuel des ingénieurs et techniciens qui développent les outils numériques modernes et assure leur maintenance que pour les ouvriers qui produisent des marchandises. Mais ce n’est guère le temps passé qui fait la valeur des produits du travail intellectuel. Une découverte scientifique n’a pas la nature d’une marchandise malgré tous les efforts pour la plier à cette logique par le biais du système des brevets. Elle ne vient pas s’ajouter à cette « immense accumulation de marchandises » qui caractérise les marchés capitalistes. Elle se prête mal à une appropriation privée. Une innovation est par nature un bien public que capitalisme a beaucoup de mal à maîtriser. Son application industrielle modifie la structure sectorielle de l’économie (par le développement du secteur tertiaire au détriment des secteurs primaires et secondaires), ainsi que les spécificités, la répartition et la qualification des emplois (les emplois qualifiés plutôt que les emplois d’exécution). Elle appelle par sa nature même l’apparition d’un nouveau régime de propriété et partant d’un autre mode de production fondé sur le partage et la mise en commun des produits du travail et sur la démocratisation des choix économiques allant vers plus de durabilité.
Une classe révolutionnaire ? Bien qu’on puisse identifier une classe montante et des classes en déclin, gardons nous pourtant de croire qu’il y aurait une classe ou des classes qui seraient révolutionnaires par nature. Il n’y a pas de classe qui « n’aurait à perdre que ses chaînes ». Il faut se garder de cette vision quasi religieuse du monde ouvrier. Moins les travailleurs possèdent de biens, plus ils sont dépendants du revenu de leur travail, plus ils ont à perdre à une interruption de la production qui les contraindrait à l’inactivité, au chômage. Ils ne deviennent révolutionnaires politiquement que lorsque leur situation ne leur permet plus la vie décente auxquels ils aspirent, lorsque leurs droits sont bafoués et qu’ils subissent une oppression insupportable. Cela se traduit actuellement par l’aspiration à la restauration d’une situation ancienne pensée comme plus favorable. Ce n’est que par l’expérience de l’échec de cet espoir de restauration qu’une classe se résout à rechercher une issue politiquement révolutionnaire et progressiste à sa situation. De même la classe des travailleurs de la science et de la technique, si elle a besoin de se libérer des carcans que les soucis de rentabilité immédiate des financiers mettent à son travail, n’aspire pas pour autant spontanément à un bouleversement des structures sociales.
La révolution malgré soi ! Une classe est révolutionnaire, non par une espèce de prédestination, mais d’abord parce qu’elle révolutionne de fait la société et modifie le régime de la propriété. Les classes sociales modernes (bourgeoises et prolétariennes) ont ainsi été des classes révolutionnaires tout au long du 19 et du 20ème siècle mais l’étaient déjà de fait à l’intérieur de la société féodale. Les classes liées à l’industrie ont transformé la société par le machinisme, l’électricité, l’automobile etc. Pendant cette période de révolution industrielle la classe montante des ouvriers était à la fois la classe révolutionnaire et la classe montante.
La révolution aujourd’hui : La classe qui révolutionne les modes de vie est aujourd’hui de plus en plus la classe de la science et des techniques. C’est par elle que se fait l’informatisation de la société, le développement des communications, des outils de calculs et d’organisation ultra performants. Cette classe est donc une nouvelle classe révolutionnaire. Mais son mode de vie, ses revenus confortables, ses aspirations, sa conscience, diffèrent de celles de la classe ouvrière. Elle est révolutionnaire d’une autre manière, avec d’autres outils, d’autres idées et d’autres aspirations. Elle cherche confusément à imposer un nouveau régime de propriété. Elle ne peut devenir révolutionnaire politiquement que différemment, en prenant conscience que la science et la technique qu’elle développe, sous la domination capitaliste, desservent et oppressent l’humanité au lieu de la servir et de l’émanciper, qu’ils sont accaparés indûment pour servir à l’accumulation financière plutôt qu’à l’amélioration de la vie, qu’ils sont dilapidés dans des productions ludiques aliénantes, que leur développement exponentiel est insoutenable et contribue même à la destruction du vivant et au dérèglement du climat et font du capitalisme un système mortifère, un exterminisme.
***
Nouvelle lutte des classes, nouveaux acteurs : La classe montante (ouvrière au 19ème siècle, scientifique au 21ème) est toujours une classe minoritaire. C’est aussi une classe sans passé et qui ne peut donc pas aspirer à une restauration. C’est une classe qui a une faible conscience de sa nature de classe. Elle a donc besoin d’une avant-garde qui l’organise et lui apporte les outils intellectuels de sa prise de conscience, qui lui ouvre des perspectives.
C’est le rôle du mouvement communiste et ce qui le définit. Il apporte à la classe productive montante, aux classes révolutionnaires (pratiquement) les outils de leur prise de conscience pour en faire des classes révolutionnaires politiquement. Le mouvement communiste au 21ème siècle doit donc s’adresser à la classe productive montante, ou plutôt aux classes productives montantes anciennes et nouvelles et leur apporter les idées qui leur permettront de s’émanciper de l’influence bourgeoise en leur sein.
Une classe montante étant toujours minoritaire a besoin d’alliés. Elle ne peut les trouver qu’en rompant avec son pendant bourgeois et en se tournant vers la classe productive qui achève sa montée : la classe ouvrière. Cette classe ouvrière est certes en repli mais reste puissante car elle ne peut pas disparaitre puisqu’elle produit tous les biens matériels nécessaires à la vie. Elle a en son sein un secteur qui développe les sources d’énergie nouvelles et les matériels indispensables au développement des réseaux informatiques (principalement le nucléaire).
Le mouvement communiste doit concilier les aspirations de ces deux classes productives et les harmoniser. Il doit tenir un discours audible des uns comme des autres. C’est son rôle historique pour hâter la transformation d’une société qui se heurte aux excès du capitalisme qui mettent en danger l’humanité « en épuisant les deux seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur », dans une course au profit qui dérègle le climat et l’équilibre du vivant.
Unité de classes : Un parti communiste moderne doit s’ouvrir à la classe des travailleurs de la science, avec un langage adapté et sans vouloir la mettre à la remorque d’une classe ouvrière idéalisée. Comme la révolution russe n’a pu réussir que par l’alliance des ouvriers d’industrie, minoritaires mais classe productive montante, avec la masse innombrable de la paysannerie voulant posséder la terre qu’elle travaillait, la révolution du 21ème siècle ne peut se faire que par l’alliance de la classe ouvrière (principalement celle des sources d’énergie moderne et de la classe des travailleurs de la science (nouvelle classe montante) entrainant derrières elles les autres classes et groupes sociaux du pôle prolétarien. Elle répétera ainsi le geste de la révolution française célébré ainsi par Marx : « La bourgeoisie française n’abandonna pas un instant ses alliés, les paysans. Elle savait que la base de sa domination était la destruction de la féodalité à la campagne, la création d’une classe libre, possédant des terres« . Elle aura ainsi suivi, en l’adaptant à notre temps, le conseil de Staline dans « Matérialisme dialectique et matérialisme historique » : « Il faut fonder son action non pas sur les couches sociales qui ne se développent plus, même si elles représentent pour le moment la force dominante, mais sur les couches sociales qui se développent et qui ont de l’avenir, même si elles ne représentent pas pour le moment la force dominante. »
Un communisme renouvelé et adapté : Les luttes de classes au 21ème siècle ont toujours le même objet, qui est la maitrise du surplus social mais elles sont plus complexes. Elles exigent un renouvellement institutionnel et de la pensée. Elles impliquent de nouveaux acteurs, une nouvelle classe productive montante, des objets nouveaux (immatériels). Elles se portent de plus en plus à l’international et se présentent sous la forme d’une lutte d’influence entre nations prolétaires, c’est-à-dire celles qui produisent l’essentiel du surplus social et les nations impérialistes qui le captent par le biais du système monétaire international et par les mécanismes de la finance. Les premières menées par la Chine sont des pays qui exportent massivement leur production et développent les réseaux d’échange nouveaux (nouvelles routes de la soie) tandis que les seconds menés par les USA les consomment et, pour faire durer cet avantage, doivent lutter pour leur hégémonie. L’objet de cette lutte internationale passera par le renversement de la domination du dollar et du monde de la finance. Il se doublera d’une lutte pour le contrôle de l’information et des réseaux sociaux internationaux. Ces luttes seront menées sous la contrainte des crises multiples : financière, écologique et de civilisation. Elles devront prendre en compte la perspective, très proche à l’échelle de l’histoire, de l’épuisement de certains métaux nécessaires à l’industrie et des énergies fossiles. Ces luttes porteront sur les deux axes identifiés (le système familial et le régime de propriété). Elles passeront nécessairement par la prise de contrôle de l’institution régulatrice étatique comme principal outil de maîtrise du surplus social (budgets sociaux, éducation, santé etc.) . Le contrôle étatique aura aussi pour but l’instauration d’une démocratie réelle (populaire) de citoyens éduqués et bien informés.
En ce qui concerne le système familial, la lutte aura pour objectif de réguler la croissance démographique. Elle devra se mener sur deux fronts à la fois contre le conservatisme misogyne et contre le wokisme en ce qu’il travaille à détruire l’institution régulatrice des rapports en les sexes qu’est la famille, qu’il rejette l’universalisme et les luttes de classes pour promouvoir une société « arc-en-ciel » faite de groupes multiples victimes de « discriminations » et dotés chacun d’une culture propre etc. Cette lutte contre le wokisme est fondamentale sinon les économies développées seront de plus en plus confrontées à la contrainte d’une population active en diminution. Avec pour conséquence une réduction du surplus social et un blocage des bases du développement donc des capacités à innover et à faire face aux défis environnementaux. Elle doit permettre de libérer les potentialités féminines tout en assurant la stabilité nécessaire à l’épanouissement des nouvelles générations.
Pour la question de la propriété, le point central sera la lutte de classe pour un partage raisonné des ressources limitées, pour la maitrise du surplus social par l’impôt et les prélèvements sociaux, pour une propriété collective adaptée au développement des technologies du numérique, et pour une maitrise de l’usage des énergies primaires émettrices de gaz à effet de serre. La propriété nouvelle sera celle d’un socialisme moderne, qui ne sera ni étatiste ni collectiviste.
Nous entrons donc dans une époque de luttes sociétales et de classes intenses et nouvelles auxquelles il faut nous préparer intellectuellement et organisationnellement.
- voir l’article du 16 juin 2013
- Lire : « une histoire du travail de la préhistoire à nos jours » de Paul Cockshott – Éditions critiques