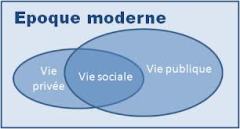Hannah Arendt commence ce quatrième chapitre de « condition de l’homme moderne », chapitre consacré à l’œuvre, en convenant une nouvelle fois de la faiblesse de la tripartition des activités humaines en travail, œuvre et action, distinction qui est pourtant la base de son étude. Les domaines se recouvrent et même se confondent à tel point que l’amalgame semble justifié ! Elle écrit (page 189) : « Bien que l’usage ne soit pas la consommation, pas plus que l’œuvre n’est le travail, ils paraissent se recouvrir en certains domaines importants, au point que l’accord unanime avec lequel les savants comme le public ont confondu ces choses différentes semble bien justifié ». Il lui faut donc, pour maintenir sa distinction, à la fois accentuer l’opposition entre travail et œuvre et lui découvrir un fondement ontologique.
Hannah Arendt commence ce quatrième chapitre de « condition de l’homme moderne », chapitre consacré à l’œuvre, en convenant une nouvelle fois de la faiblesse de la tripartition des activités humaines en travail, œuvre et action, distinction qui est pourtant la base de son étude. Les domaines se recouvrent et même se confondent à tel point que l’amalgame semble justifié ! Elle écrit (page 189) : « Bien que l’usage ne soit pas la consommation, pas plus que l’œuvre n’est le travail, ils paraissent se recouvrir en certains domaines importants, au point que l’accord unanime avec lequel les savants comme le public ont confondu ces choses différentes semble bien justifié ». Il lui faut donc, pour maintenir sa distinction, à la fois accentuer l’opposition entre travail et œuvre et lui découvrir un fondement ontologique.
Première opposition encore superficielle : fin et destin : la qualité première des produits de l’œuvre est leur durabilité. Celle-ci n’est pas « absolue » mais elle est la fin visée par l’homo faber lors de leur création, alors que « la destruction est la fin inhérente » aux produits du travail ; leur destin est d’être détruit dans la consommation.
Opposition fondamentale : c’est la position des hommes face aux produits de l’œuvre qui distingue fondamentalement ces produits des fruits du travail. Les produits de l’œuvre ont une présence, une objectivité qui s’impose à la subjectivité humaine et s’oppose à elle. « A la subjectivité des hommes s’oppose l’objectivité du monde fait de main d’homme bien plus que la sublime indifférence d’une nature vierge ». La nature renvoie l’homme à son être biologique. Il prend conscience de sa faiblesse et de sa finitude. Mais, face à ses produits, l’homme dépasse sa finitude : il sent un sujet. Le thème romantique cède devant l’épopée prométhéenne du progrès.
Toute opposition de ce type est éminemment contestable mais il est inutile ici d’entrer dans une discussion. Il parait plus intéressant de voir comment Hannah Arendt va renforcer l’opposition, comment elle la creuse. Je ne suivrai pas ici l’ordre de la présentation. Les ressorts de l’argumentation paraissent bien mieux si on en restitue la logique. Une logique en deux temps : il s’agit d’abord de dévaluer le travail pour marquer une distance avec l’œuvre. Ensuite, il s’agira d’attribuer à l’œuvre une vigueur ontologique que n’a pas le travail.
Un exemple de la dévaluation est donné par ce passage : « A la différence de l’animal laborans dont la vie est grégaire et sans monde, et qui par conséquent est incapable de construire ou d’habiter un domaine public, du-monde, l’homo faber est parfaitement capable d’avoir un domaine public à lui, même s’il ne s’agit pas de domaine politique à proprement parler. Son domaine public, c’est le marché …. ». Encore une fois, il me parait inutile de vouloir réfuter une affirmation aussi manifestement construite pour produire un effet. Qui dira que les producteurs céréaliers ont un comportement plus grégaire que ceux qui qui produisent des meubles, ou qu’ils ignorent ce qu’est un marché ? Ce qui apparait surtout c’est qu’une nouvelle fois la définition du travail a subi une inflexion. Son image est maintenant celle de l’ouvrier d’usine et même plus spécifiquement celui du travailleur à la chaîne. Page 149, les fruits du travail étaient voués à la consommation immédiate. Cela les différenciait des produits de l’œuvre qui constituaient le monde humain. Or, s’il est un objet qui a modifié notre environnement au cours du dernier siècle, c’est bien l’automobile. Difficile de ne pas la voir comme un produit de l’œuvre. Pourtant le travailleur de l’industrie automobile ne participe pas à l’œuvre mais au travail. Voyons pourquoi :
 L’activité des ouvriers de l’automobile relève du travail et non de l’œuvre parce que toute créativité en a été retirée. Le travail prend ici, en fait, le sens de « labeur ». Il n’est plus défini par son produit comme au chapitre précédent mais par sa forme. Le thème marxiste de l’aliénation semblait s’imposer pour le décrire. Quelques passages vont dans ce sens, mais ce n’est pas le fond. Le discours bascule à l’inverse : l’ouvrier se plait à son travail ! Ainsi : « Toutes ces théories semblent très contestables du fait que les ouvriers expliquent eux-mêmes de façon toute différente leur préférence pour le travail répétitif. Ils le préfèrent parce qu’il est mécanique et n’exige pas d’attention, de sorte qu’en l’exécutant ils peuvent penser à autre chose ». Les travailleurs de la chaine « paraissent trouver dans le fonctionnement de la machine le même plaisir que dans tout travail répétitif ».
L’activité des ouvriers de l’automobile relève du travail et non de l’œuvre parce que toute créativité en a été retirée. Le travail prend ici, en fait, le sens de « labeur ». Il n’est plus défini par son produit comme au chapitre précédent mais par sa forme. Le thème marxiste de l’aliénation semblait s’imposer pour le décrire. Quelques passages vont dans ce sens, mais ce n’est pas le fond. Le discours bascule à l’inverse : l’ouvrier se plait à son travail ! Ainsi : « Toutes ces théories semblent très contestables du fait que les ouvriers expliquent eux-mêmes de façon toute différente leur préférence pour le travail répétitif. Ils le préfèrent parce qu’il est mécanique et n’exige pas d’attention, de sorte qu’en l’exécutant ils peuvent penser à autre chose ». Les travailleurs de la chaine « paraissent trouver dans le fonctionnement de la machine le même plaisir que dans tout travail répétitif ».
Traditionnellement le travail répétitif est celui qui s’accompagne de chants. Sur cette base, l’œuvre et le travail s’opposent : le travail est mécanique et rythmé, l’artisan varie son rythme et ne chante qu’une fois l’ouvrage achevé. « Le travail, et non pas l’œuvre, exige pour bien réussir une exécution rythmée, et lorsque plusieurs travailleurs font équipe, il faut une coordination rythmique de tous les gestes individuels ». L’œuvre exige l’initiative. Le travail est un processus vital : « l’activité de travail fait intégralement partie [du processus vital] elle ne [le] transcende jamais ». On suppose qu’il faut comprendre ici « vital » comme opposé à social.
Enfin, l’homo faber est celui qui allège le labeur de l’animal laborans, ce qui achève de les opposer et les hiérarchise clairement. Cette dernière différence permet de passer au deuxième temps de la stratégie de rétablissement de la distinction entre travail et œuvre : la différence ontologique. Elle s’exprime ainsi : « L’œuvre factuelle de fabrication s’exécute sous la conduite d’un modèle conformément auquel l’objet est construit ». C’est la position téléologique dont Marx faisait un trait constitutif de l’humanité et qu’il rapportait au travail comme fait anthropologique, comme « acte qui se passe entre l’homme et la nature ».
Hannah Arendt n’utilise pas l’expression « position téléologique » car cette expression ne s’accorderait pas avec sa volonté de la réserver à un type d’homme : l’homo faber. Elle dévie vers une discussion au sujet de Protagoras et de son « homme mesure de toute chose ». Je ne développerai pas cela car il me semble que c’est hors de propos et qu’il faudrait discuter le sort fait à Protagoras par Platon. Ce n’est pas le sujet !
Restons en à la position téléologique. Qu’est-ce que la position téléologique ? Marx en fait la base de l’humanisation de l’homme, de la sortie de l’homme du règne animal. Si, pour expliquer cela, je reprends intégralement mon article facebook du 13 janvier (d’après Lukàcs), c’est que je n’ai pas trouvé le moyen de le résumer. Le voici donc :
« « Comment expliquer l’hominisation de l’homme ? Comment des dispositions anatomiques et comportementales ont-elles permis le passage du singe à l’homme ? Comment passe-t-on des fonctions biologiquement fixées propres à l’animal à l’adaptation transmissible et évolutive propre à l’homme ? Comment expliquer l’apparition de la vie sociale et du langage ?
Ce passage fut sans doute extrêmement lent. Il n’en a pas moins le caractère d’une rupture et d’un saut qualitatif. Il pourrait avoir son origine, son point de départ, dans une activité en germe chez l’animal mais qui acquiert chez l’homme une forme qui lui appartient exclusivement. Cette activité est, selon Marx, le travail. Il le définit et le caractérise ainsi : « Notre point de départ, c’est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l’homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire l’habilité de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travailleur aboutit préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles ; il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action, et auquel il doit subordonner sa volonté ».
 Par le travail une position téléologique, un projet humain, se réalise matériellement. Cette réalisation s’accomplit au travers de médiations qui peuvent être très ramifiées et complexes. Cette forme propre au travail d’être la réalisation d’une position téléologique est la caractéristique commune à toutes les activités véritablement humaines. La généralisation de ce fait élémentaire est constitutive de l’expérience ou de l’activité de tout être humain. Elle est commune à toutes les modalités de ses expériences ou activités, des plus rudimentaires jusqu’aux plus complexes.
Par le travail une position téléologique, un projet humain, se réalise matériellement. Cette réalisation s’accomplit au travers de médiations qui peuvent être très ramifiées et complexes. Cette forme propre au travail d’être la réalisation d’une position téléologique est la caractéristique commune à toutes les activités véritablement humaines. La généralisation de ce fait élémentaire est constitutive de l’expérience ou de l’activité de tout être humain. Elle est commune à toutes les modalités de ses expériences ou activités, des plus rudimentaires jusqu’aux plus complexes.
Parce qu’il implique une position téléologique, le travail enclenche le processus de l’humanisation. Les autres caractéristiques de l’humain, comme le langage, présentent déjà un caractère social. Leurs particularités, leurs modes d’action ne se déploient que dans un être social déjà constitué. Elles présupposent que le saut vers l’humain ait déjà eu lieu. Seul le travail comme interaction de l’homme avec la nature, devenant consciente, engage un processus cumulatif, évolutif et transmissible.
Les plus grands penseurs, d’Aristote à Hegel, ont compris de la manière la plus claire le caractère téléologique du travail. Leurs analyses conservent aujourd’hui toute leur validité à ceci près toutefois qu’ils ne limitent pas la position téléologique au travail et aux pratiques humaines mais l’élèvent au rang d’une catégorie générale cosmologique : ils empruntent aux religions l’idée d’une finalité du monde et créent ainsi une concurrence constante, une antinomie entre téléologie et causalité. Hegel fait de la téléologie le moteur de l’histoire et de toute sa conception du monde. Aristote a pour modèle la biologie, il est fasciné par l’apparente finalité qui préside au développement du vivant. Il invente la notion de cause finale. Descartes imagine la création continuée et Leibniz l’idée d’harmonie préétablie.
Pour les philosophes, le problème est de concilier la causalité comme principe d’un mouvement autonome avec cette téléologie généralisée qui implique un créateur conscient initiant les processus du réel. La téléologie cosmologique comporte nécessairement la fixation d’un objectif et par conséquent une conscience qui le pose. Elle est pensée sur le modèle des séries causales initiées par la conscience humaine mais en raffine la forme pour satisfaire le besoin humain d’un sens de l’existence.
L’homme a besoin que tout ce qui arrive ait un sens. Dans la détresse et le désarroi, il voudrait connaitre le pourquoi des choses. Ce besoin, si persistant dans la vie quotidienne, pénètre tous les domaines de la vie personnelle immédiate. Le ramener à sa source originelle, à la logique du travail, exige un grand effort de lucidité. Il est peut-être encore plus difficile de comprendre que dans les pratiques magiques, dans la prière et l’imploration, la conscience est contaminée par la position téléologique qui a son origine dans le travail, que cette position est le fondement de la religiosité et de toutes les activités qu’elle inspire. » »
Ce qui chez Marx est la caractéristique commune à toutes les activités humaines (et dont la genèse ontologique est dans le travail) se trouve ramené à l’œuvre seule (en opposition au travail qui est, du coup, dévalorisé). Hannah Arendt retient essentiellement l’idée que les moyens, les méthodes mises en œuvre sont dictées par le but anticipé. Mais un jardinier n’anticipe-t-il donc pas ? lui dont l’activité relevait du travail au sens qu’il avait au chapitre 3. C’est un des procédés qui revient constamment dans « condition de l’homme moderne » : reprendre une idée et la calibrer pour l’ajuster à son propos. C’est ce qui est fait aussi avec le thème de la « réification » qui se trouve ramené au sens de fabriquer des objets. Il me parait, dès lors, inutile de le discuter puisqu’il est purement tautologique : il est déjà contenu dans la définition de l’œuvre. L’autre procédé consiste à revenir sur ce qui vient d’être dit pour l’atténuer ou le réajuster. Le chapitre IV n’échappe pas à cela mais, pour ne pas être trop long, je reviendrai dans un prochain article sur ce qui, dans le même chapitre, contrarie la mise en valeur de l’œuvre et l’éloigne de la pensée et de l’art (qui font leur apparition comme activités humaines non mentionnées jusque là).