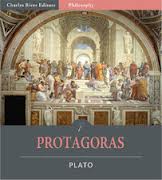 Sextus Empiricus reproche à Protagoras d’affirmer « que toutes les représentations et les opinions sont vraies ». Cette proposition surprenante ne peut être discutée que pour autant qu’on admette déjà que chacun croit, et croit légitimement, que ses représentations et ses opinions sont vraies. Chacun part de son constat brut et s’efforce de l’interpréter correctement. Pour tout homme, comme pour Protagoras lui-même, la base première du savoir reste la certitude « animale ». Chacun s’appuie sur la confiance qu’il a en ses sens, sur l’assurance que lui donnent son corps et la clarté de sa pensée. Mais, comme Protagoras lui-même, aucun homme n’en reste pas là. Chacun effectue un passage de la saisie du réel à la pensée du vrai. Avant même que l’idée de vrai se soit clarifiée selon ce qu’a montré Michel Foucault, chaque homme vivait et agissait comme s’il avait une idée claire du vrai. Pour tout homme se confronter au réel et faire l’expérience du vrai, était une seule et même chose. Il en était ainsi car cela est la base indispensable à toute relation sociale.
Sextus Empiricus reproche à Protagoras d’affirmer « que toutes les représentations et les opinions sont vraies ». Cette proposition surprenante ne peut être discutée que pour autant qu’on admette déjà que chacun croit, et croit légitimement, que ses représentations et ses opinions sont vraies. Chacun part de son constat brut et s’efforce de l’interpréter correctement. Pour tout homme, comme pour Protagoras lui-même, la base première du savoir reste la certitude « animale ». Chacun s’appuie sur la confiance qu’il a en ses sens, sur l’assurance que lui donnent son corps et la clarté de sa pensée. Mais, comme Protagoras lui-même, aucun homme n’en reste pas là. Chacun effectue un passage de la saisie du réel à la pensée du vrai. Avant même que l’idée de vrai se soit clarifiée selon ce qu’a montré Michel Foucault, chaque homme vivait et agissait comme s’il avait une idée claire du vrai. Pour tout homme se confronter au réel et faire l’expérience du vrai, était une seule et même chose. Il en était ainsi car cela est la base indispensable à toute relation sociale.
Pour qu’il puisse y avoir une vérité commune, il faut qu’il soit admis que chacun a effectué ce passage du savoir animal à l’acceptation du constat brut et à la certitude de saisir le réel et donc le vrai. Il faut, pour qu’il y ait des vérités communes, qu’il y ait d’abord des vérités individuelles intimement vécues comme telles. Il faut, pour qu’il y ait une vérité commune, qu’il y ait la possibilité de vérités relatives. C’est ce que Sextus Empiricus fait dire très clairement à Protagoras : « la vérité est de l’ordre du relatif puisque tout ce qui est objet de représentation ou d’opinion pour quelqu’un est immédiatement doté d’une existence relative à lui ». La proposition se comprend mieux encore si on la retourne : tout ce qui est « doté d’une existence » pour quelqu’un (tout ce qui est pour lui objet d’un constat brut), est « objet de représentation » et, dès lors qu’il passe dans la conscience immédiate (et potentiellement dans le discours), devient vérité. Tout ce qui apparaît réel à quelqu’un est vrai pour lui puisque le vrai est la saisie du réel : ce qui apparaît réel apparaît vrai. Toute discussion, toute recherche d’un vrai commun, ne sont possibles que si on accepte cela.
La vérité ainsi atteinte est une vérité relative, mais ce n’en n’ait pas moins une vérité. C’est même une vérité plus sûre que celle que pourra fonder une discussion car elle est plus proche du savoir « animal » ; elle en sort tout juste et y reste intimement liée. Cette vérité est celle que chaque homme se donne sur la base de son expérience. C’est celle qui lui fait dire que le feu brûle et, avant même de le dire, qui fait éviter d’y mettre la main. Cette vérité est à l’œuvre quand une mère écarte son enfant du feu. La mère projette sur son enfant la certitude animale qu’elle a du danger car cette certitude s’est muée en une vérité, c’est-à-dire en quelque chose qui est vrai relativement à elle dans sa source mais dont le fondement est si fermement assuré qu’elle le vit comme valant pour tous, à commencer par son enfant. C’est la même vérité qui permet à celui qui a expérimenté la chose de dire que l’huile est bonne pour l’usage externe mais très mauvaise pour l’usage interne. C’est la vérité qui est à la base d’un discours sur l’utile et le nuisible tel que celui que Platon prête à Protagoras (dans le dialogue qui porte son nom) et dont il se moque (1). On peut penser que si Protagoras tient ce petit discours du sens commun et de l’expérience première comme celle du jardinier, c’est pour faire comprendre que la vérité « relative » est celle qui est la plus proche de l’expérience la plus commune. La vérité « relative » ainsi dégagée est en même temps la plus commune. Elle est le propre de tout homme et elle est aussi sûre et indigente que le permet la nature humaine.
Protagoras termine son petit discours sur l’utile par cette remarque : « Voilà pourquoi tous les médecins interdisent aux malades l’usage de l’huile, ils ne leur en laissent absorber qu’à très petite dose, juste assez pour chasser l’impression désagréable que font les aliments et les viandes sur le sens de l’odorat ». On pourrait, comme Socrate, interpréter cela comme l’inutile étalage d’un savoir accumulé dans le seul but de briller. Socrate n’y voit qu’un ridicule morceau d’éloquence. Pourtant, si on prend cela au sérieux, il semble bien que Protagoras indique ici qu’au-dessus de la vérité relative qui appartient à tout homme mais qui est tout de même assez assurée pour qu’il veuille spontanément la partager, se construit une vérité d’expert. Au-dessus des vérités premières et à partir d’elles, se construit un savoir fondé sur des jugements qualifiés. Ce savoir est un savoir complexe où la vérité ne peut se dire qu’avec mesure. A ce niveau de discours, les oppositions doivent être nuancées, chaque affirmation doit être rapportée à son domaine de validité et à ses limites de validité. On peut voir dans le Protagoras de Platon comment Socrate peut se jouer de son interlocuteur dans leur discussion sur la vertu en ne lui permettant pas faire valoir les nuances et les difficultés de sa pensée. Mais le lecteur sent bien que Socrate bride l’expression de celui qu’il combat et ne lui permet pas d’aller jusqu’au bout de ce qu’il a à dire. La vérité que construit le savoir d’expert se prête mal à la méthode polémique de Socrate car elle est faite de propositions qui, prises chacune isolément, peuvent aisément être mises en contradiction avec une autre. Chaque proposition ne vaut qu’accompagnée des réserves qui y sont mises. Elle a son domaine de validité qui peut être extrêmement précis. Elle peut dépendre de l’heure du jour, de la saison, ou des particularités du moment.
On peut trouver chez Hésiode, dans « les travaux et les jours », la première expression de ce type de savoir. Ainsi : « pour un chariot, il faut cent pièces de bois », ou encore l’affirmation qu’il a un temps pour labourer et un temps pour semer. Le temps pour récolter n’arrive que si les premiers ont été respectés. Chez Hésiode chaque saison, chaque jour faste ou néfaste, et chaque domaine d’activité connaît son lot de vérités. Le discours de vérité n’est pas un discours hors du temps. Il est, au contraire, intimement lié au temps et à ce qu’on voit, qu’on constate et qu’il faut noter avec soin. Ainsi le laboureur doit-il bien voir si l’eau reste au-dessous du sabot de ses bœufs, car cela permet de mesurer l’humidité de la terre. Le laboureur est dépositaire d’un savoir mais d’un savoir qui n’est plus animal et qui n’est plus relatif à lui. Ce savoir est moins assuré que le savoir qu’il a relativement à son expérience immédiate mais il est aussi plus précieux. Ce savoir a été construit par l’échange des expériences entre les hommes. C’est un savoir partagé et largement expertisé.
 Entre la vérité relative et la vérité qualifiée de l’expert, se situe le temps de l’échange et du débat. C’est le moment où les vérités relatives se confrontent en se présentant comme des opinions. Ici, les choses se complexifient car on sait que Protagoras demandait à ses élèves d’être capables tenir un discours aussi bien que le discours opposé. Selon Diogène Laërce, il « fut le premier à affirmer qu’à propos de toute chose, il y a deux discours opposés l’un à l’autre ». Cette façon de le présenter peut laisser supposer qu’il lui était indifférent de dire le vrai ou le faux. Une telle désinvolture disqualifierait sa pensée. Seulement, nous venons de voir qu’il semble avoir été au contraire très soucieux de rester solidement près de l’expérience du réel et qu’il refusait toute extrapolation non autorisée par la confrontation au réel. S’il en est ainsi, cela rend autrement difficile l’exercice demandé aux élèves. Il ne s’agit plus alors de tromper l’auditeur par une rhétorique savante et par des procédés malhonnêtes ; il s’agit de trouver dans son expérience, dans ce qu’on sait d’une chose d’un savoir direct, ce qui permet de défendre une thèse et la thèse opposée. Il ne s’agit pas de contredire, ce qui serait, selon l’épistémologie de Protagoras (dans l’Euthydème), ne pas parler de la chose et donc tenir un discours vide. Il s’agit de parler de la chose autrement selon un discours « opposé » mais un discours qui est bien sur la même chose. Un tel exercice n’est alors possible que dans des domaines où un jeune Athénien a pu avoir quelques expériences. Il est donc possible surtout dans les questions philosophiques ou dans les débats politiques. Il peut permettre, par exemple, de soutenir d’abord que la démocratie vaut mieux que la tyrannie, pour ensuite inverser les rôles et soutenir que la tyrannie vaut mieux que la démocratie. Cet exercice devient alors une préparation à l’expertise, c’est-à-dire à la construction d’un discours qui peut dire dans quelle mesure et dans quelles circonstances un régime politique vaut mieux qu’un autre. L’exercice demande une bonne maitrise de la rhétorique mais aussi une connaissance précise des expériences du passé et des qualités de chacun des régimes. On est alors dans le cadre des exercices qui se font actuellement dans certaines formations professionnelles où, par exemple, il est demandé aux étudiants en économie de défendre une thèse puis la thèse opposée tantôt selon les « théories de l’offre » ou les « théories de la demande ».
Entre la vérité relative et la vérité qualifiée de l’expert, se situe le temps de l’échange et du débat. C’est le moment où les vérités relatives se confrontent en se présentant comme des opinions. Ici, les choses se complexifient car on sait que Protagoras demandait à ses élèves d’être capables tenir un discours aussi bien que le discours opposé. Selon Diogène Laërce, il « fut le premier à affirmer qu’à propos de toute chose, il y a deux discours opposés l’un à l’autre ». Cette façon de le présenter peut laisser supposer qu’il lui était indifférent de dire le vrai ou le faux. Une telle désinvolture disqualifierait sa pensée. Seulement, nous venons de voir qu’il semble avoir été au contraire très soucieux de rester solidement près de l’expérience du réel et qu’il refusait toute extrapolation non autorisée par la confrontation au réel. S’il en est ainsi, cela rend autrement difficile l’exercice demandé aux élèves. Il ne s’agit plus alors de tromper l’auditeur par une rhétorique savante et par des procédés malhonnêtes ; il s’agit de trouver dans son expérience, dans ce qu’on sait d’une chose d’un savoir direct, ce qui permet de défendre une thèse et la thèse opposée. Il ne s’agit pas de contredire, ce qui serait, selon l’épistémologie de Protagoras (dans l’Euthydème), ne pas parler de la chose et donc tenir un discours vide. Il s’agit de parler de la chose autrement selon un discours « opposé » mais un discours qui est bien sur la même chose. Un tel exercice n’est alors possible que dans des domaines où un jeune Athénien a pu avoir quelques expériences. Il est donc possible surtout dans les questions philosophiques ou dans les débats politiques. Il peut permettre, par exemple, de soutenir d’abord que la démocratie vaut mieux que la tyrannie, pour ensuite inverser les rôles et soutenir que la tyrannie vaut mieux que la démocratie. Cet exercice devient alors une préparation à l’expertise, c’est-à-dire à la construction d’un discours qui peut dire dans quelle mesure et dans quelles circonstances un régime politique vaut mieux qu’un autre. L’exercice demande une bonne maitrise de la rhétorique mais aussi une connaissance précise des expériences du passé et des qualités de chacun des régimes. On est alors dans le cadre des exercices qui se font actuellement dans certaines formations professionnelles où, par exemple, il est demandé aux étudiants en économie de défendre une thèse puis la thèse opposée tantôt selon les « théories de l’offre » ou les « théories de la demande ».
Protagoras se situe vraisemblablement dans le cadre des questions philosophiques. Cela se confirme par ce qu’écrit Diogène Laërce : «Protagoras dit qu’à propos de toute chose il est possible de soutenir des positions contraires avec autant de pertinence, à commencer par la question même qui est en cause, c’est-à-dire celle de savoir s’il est possible de soutenir des positions contraires à l’importe quel propos ». On voit bien ici que s’il s’agissait de discuter de choses triviales, une telle idée serait absurde. Mais la discussion sur la dualité ou le caractère absolu de la vérité qui est proposée en exemple, n’a rien de trivial. C’est une discussion philosophique fondamentale et certainement la plus indispensable à l’élève s’il veut maitriser l’art de la dispute tel que le propose Protagoras. C’est une discussion éminemment philosophique et c’est celle qui permet le mieux de comprendre ce qu’est une discussion philosophique. Il ne s’agit certainement pas ici de dire que « à propos de toute chose on peut affirmer ou nier n’importe quoi » comme voudrait le comprendre Aristote. Il s’agit plutôt de dire qu’une vérité experte définitive et complète n’est jamais définitivement atteinte, close et totalement exempte de difficulté. Une vérité experte est toujours une synthèse de vérités opposées ou au moins non conciliées. Elle est faite de propositions opposées et n’est qu’un agencement sous conditions de ces propositions. La vérité experte admet et même se fonde sur le constat que les propriétés des choses reçoivent leur forme de celui qui expérimente. L’exemple canonique qui illustre cette conditionnalité des propriétés est donné par le miel qui est doux à celui qui est en bonne santé et amer pour celui qui est fiévreux. La propriété d’une chose s’exprime eu égard à celui qui en fait l’expérience. Elle est la propriété de la chose pour lui, dans le moment où il en perçoit l’expression. Il peut même tenter de renverser sa compréhension en essayant de penser tantôt la propriété de ce qui est touché du point de vue de celui qui touche puis la propriété de celui qui touche selon ce qui est touché. Le doux devient alors le rugueux, le froid est le chaud et ainsi en est-il de toutes les propriétés. Les propriétés s’inversent et contiennent alors leur opposé.
La discussion philosophique, qui est la recherche d’un vrai commun, n’est pas de même nature que le débat judiciaire. Devant le tribunal, l’un accuse et l’autre dément. Nécessairement, si l’un dit la vérité, l’autre ment. On est dans l’ordre du différend ou plutôt, selon l’épistémologie de Protagoras, dans le cas où l’un parle de l’objet du litige et l’autre de « rien du tout ». La condition première d’une discussion n’est pas remplie ; cette condition, c’est que chacun rende compte de sa propre saisie du réel, que chacun dise le « réel ». C’est pourquoi le débat judiciaire se déroule devant un tiers (le juge) dont on n’attend pas qu’il accorde les parties sur une vérité commune, mais qui doit trancher en faveur de l’une contre l’autre (ou les renvoyer toutes les deux). Dans la discussion philosophique, il en va tout autrement. En philosophie, Protagoras peut dire « qu’il y a sur tout sujet deux discours mutuellement opposés » ou « à tout discours s’oppose un autre discours ». Il en va de même dans la discussion politique. Dans le débat politique, on cherche ce qui est bon pour la Cité. Ce qui s’affronte, ce sont deux conceptions différentes du bon pour la cité et les discours sont ceux des partis qui ont chacun une perception différente du réel. Dans ces deux types de discours, philosophique et politique, c’est donc deux perceptions du réel, donc deux vérités, qui s’affrontent. Il serait absurde de soutenir que Protagoras étend ce principe à toute espèce de discours, dans toute espèce de situation, autrement que de façon théorique et spéculative. Ce principe se conçoit par exemple dans le cadre d’une discussion purement philosophique sur l’idée de propriété telle que nous l’avons imaginée. Dans la pratique courante l’idée d’une dualité, de discours opposés trouve peu d’applications utiles, elle ne serait qu’un inutile débat sur les goûts et les couleurs. Elle n’a tout son sens que dans la discussion philosophique ou politique.
Le débat  tel que le conçoit Protagoras n’est pas la dispute. Il s’en distingue par le fait qu’il repose sur des arguments. Socrate le rappelle très clairement dans le « Théétète » quand il dit : «Il disait que l’opinion vraie accompagnée de raison est science, mais que, dépourvue de raison, elle est en dehors de la science, et que les choses dont on ne peut rendre raison sont inconnaissables […] celles dont on peut rendre raison, connaissables ». Ainsi se boucle le parcours de la connaissance. Elle a commencé sous la forme du savoir par le constat de l’existence et par l’idée que la non-existence ne peut pas être l’objet d’un savoir. Elle est passée du savoir « animal » à la vérité relative à l’expérience propre à chacun. Son ferme appui dans la certitude « animale » a conduit à la vivre comme une vérité et à la projeter sur l’autre. Il est alors apparu que la vérité la plus proche du savoir animal, la plus relative donc, est en même temps la plus commune. Cette vérité relative s’est présentée comme opinion et, dans le débat, par la discussion, elle a permis la construction d’un savoir expert qui doit être appelé une connaissance ou une science s’il repose sur des arguments correctement établis. La science est donc le savoir expert quand il n’est pas seulement fruit de l’expérience mais qu’il est raisonné. Protagoras distingue donc, semble-t-il, une expertise populaire comme celle du jardinier, celle des gens qui ont une pratique variée et complète, et l’expertise savante qui est raisonnée qui démontre ses propositions et les exprime avec précision et justesse. La différence entre l’expertise populaire et l’expertise savante porte aussi vraisemblablement sur leur objet. La première s’occupe des choses de la vie pratique tandis que la seconde va vers les choses abstraites et les questions débattues par la philosophie et la religion.
tel que le conçoit Protagoras n’est pas la dispute. Il s’en distingue par le fait qu’il repose sur des arguments. Socrate le rappelle très clairement dans le « Théétète » quand il dit : «Il disait que l’opinion vraie accompagnée de raison est science, mais que, dépourvue de raison, elle est en dehors de la science, et que les choses dont on ne peut rendre raison sont inconnaissables […] celles dont on peut rendre raison, connaissables ». Ainsi se boucle le parcours de la connaissance. Elle a commencé sous la forme du savoir par le constat de l’existence et par l’idée que la non-existence ne peut pas être l’objet d’un savoir. Elle est passée du savoir « animal » à la vérité relative à l’expérience propre à chacun. Son ferme appui dans la certitude « animale » a conduit à la vivre comme une vérité et à la projeter sur l’autre. Il est alors apparu que la vérité la plus proche du savoir animal, la plus relative donc, est en même temps la plus commune. Cette vérité relative s’est présentée comme opinion et, dans le débat, par la discussion, elle a permis la construction d’un savoir expert qui doit être appelé une connaissance ou une science s’il repose sur des arguments correctement établis. La science est donc le savoir expert quand il n’est pas seulement fruit de l’expérience mais qu’il est raisonné. Protagoras distingue donc, semble-t-il, une expertise populaire comme celle du jardinier, celle des gens qui ont une pratique variée et complète, et l’expertise savante qui est raisonnée qui démontre ses propositions et les exprime avec précision et justesse. La différence entre l’expertise populaire et l’expertise savante porte aussi vraisemblablement sur leur objet. La première s’occupe des choses de la vie pratique tandis que la seconde va vers les choses abstraites et les questions débattues par la philosophie et la religion.
A ce niveau resurgit l’inconnaissable. Il n’est plus ce dont l’expérience est impossible soit parce qu’il n’est pas réel mais de l’ordre de l’éventualité, soit parce qu’il est de l’ordre de ce qui n’est pas encore et ne sera peut-être jamais. Il est de l’ordre de l’abstrait, de ce que l’argumentation ne peut pas étayer par le témoignage des sens. Cet inconnaissable est ce qui ne trouve racine ni dans l’expérience première, ni dans ce qui peut avoir été rapporté comme expérience singulière. Il se découvre alors que ce qui ne pouvait pas être objet de savoir ne peut pas non plus être objet de science. L’existence des dieux dont on ne pouvait rien savoir, ne peut pas non plus être connue. Sans cesse la discussion savante est menacée de sortir des limites autorisées par la faculté de connaître pour argumenter dans le vide, sur de pures abstractions comme le sont les constructions mathématiques ou les spéculations sur les au-delà.
Cependant, comme nous l’avons vu, cette conception assez élaborée de la connaissance que nous pensons pouvoir attribuer à Protagoras s’accompagne d’un respect pour le savoir mantique. Ce respect tient sans doute aux limites d’une pensée qui ne fait que sortir d’un savoir mythologique pour se donner des appuis dans le réel. Mais il peut avoir des racines plus profondes. En effet, le texte le plus long que nous ayons à propos de Protagoras est le mythe que Platon lui prête dans son dialogue. L’objet de ce dialogue est l’homme et les raisons de ce qu’il est. Ce mythe parle de l’homme et de ses origines et de sa nature mais pourtant il parle d’un objet dont aucun homme n’a l’expérience complète. Il parle de ce dont tout homme a une intuition, au moins confuse, à partir du savoir premier qu’il a de lui-même mais dont aucun homme n’a et ne peut avoir de connaissance car il n’a de lui-même et de l’humanité qu’une vue et une expérience partielles et insignifiantes. Face à ce besoin qu’a l’homme de se connaître, la conception qu’a forgée Protagoras de la connaissance est inopérante car un débat sur la nature humaine qui voudrait rendre raison complètement de cette nature est impossible. Pourtant l’homme n’est pas comme les dieux hors de l’expérience, au contraire il est l’expérience intime de chaque homme. A ce niveau la connaissance fondée sur des raisons n’atteint pas son objet et le mythe reste un moyen légitime de dire le vraisemblable. Ici, dans l’usage du mythe et dans la conscience des limites de la connaissance, Protagoras ne se distingue pas de Platon. Le mythe est pour lui une modalité différente de la connaissance où la connaissance n’est pas une science mais où elle mérite pourtant le respect. Le mythe est nécessaire à l’homme pour penser ce qui est de l’ordre de l’expérience mais dont l’expérience est toujours infiniment incomplète.
 Protagoras ne cultive pas la connaissance pour elle-même et en esthète. Il la met au service de la vie. L’objet de la philosophie, pour Protagoras, c’est « d’avancer dans la vertu » donc de faire les choses au mieux pour soi ou pour la cité. Pour lui, l’apprentissage du savoir expert, en politique ou en philosophie ne se fait pas pour lui-même mais dans le but d’entrer dans le débat public et d’y jouer un rôle éminent. Cela suppose d’être capable d’argumenter avec suffisamment de force pour savoir démonter une thèse adversaire et la renverser pour la thèse qu’on soutient avec une véritable efficacité. Ce qui s’enseigne n’est donc pas la connaissance mais l’art d’user des connaissances et éventuellement d’en mésuser. Mais il reste si peu de choses des écrits de Protagoras comme de ceux des grands sophistes, et il s’est dit tant de choses contre eux, qu’il parait impossible d’imaginer ce que pouvait être réellement l’enseignement d’un sophiste. Ce que nous pouvons reconstituer de sa conception de la connaissance permet seulement d’affirmer que si Protagoras se disait sophiste, ce n’était pas pour revendiquer un droit au mensonge et à la tromperie. Les arguments fallacieux ont peut-être été des armes forgées par les sophistes mais certainement pas leur science. Leur vraie science est l’expression de leur mode de pensée jointe à une grande expérience de la vie des cités.
Protagoras ne cultive pas la connaissance pour elle-même et en esthète. Il la met au service de la vie. L’objet de la philosophie, pour Protagoras, c’est « d’avancer dans la vertu » donc de faire les choses au mieux pour soi ou pour la cité. Pour lui, l’apprentissage du savoir expert, en politique ou en philosophie ne se fait pas pour lui-même mais dans le but d’entrer dans le débat public et d’y jouer un rôle éminent. Cela suppose d’être capable d’argumenter avec suffisamment de force pour savoir démonter une thèse adversaire et la renverser pour la thèse qu’on soutient avec une véritable efficacité. Ce qui s’enseigne n’est donc pas la connaissance mais l’art d’user des connaissances et éventuellement d’en mésuser. Mais il reste si peu de choses des écrits de Protagoras comme de ceux des grands sophistes, et il s’est dit tant de choses contre eux, qu’il parait impossible d’imaginer ce que pouvait être réellement l’enseignement d’un sophiste. Ce que nous pouvons reconstituer de sa conception de la connaissance permet seulement d’affirmer que si Protagoras se disait sophiste, ce n’était pas pour revendiquer un droit au mensonge et à la tromperie. Les arguments fallacieux ont peut-être été des armes forgées par les sophistes mais certainement pas leur science. Leur vraie science est l’expression de leur mode de pensée jointe à une grande expérience de la vie des cités.
1 – Protagoras 333d 334d : « … je sais, moi, beaucoup de bonnes choses qui sont préjudiciables aux hommes, comme certains aliments, breuvages, drogues et quantité d’autres choses, d’autres choses qui leur sont utiles, et d’autres qui leur sont indifférentes, mais qui sont bonnes pour les chevaux. J’en sais qui sont utiles aux bœufs seulement, d’autres aux chiens. Telles qui ne sont utiles à aucun des animaux, le sont aux arbres ; et dans l’arbre, certaines sont bonnes aux racines, mauvaises aux jeunes pousses ; ainsi le fumier est bon à toutes les plantes, si on le met aux racines ; mais si on veut en couvrir les rejetons et les jeunes pousses, c’est pour gâter tout. De même l’huile est tout à fait pernicieuse à toutes les plantes, et c’est la grande ennemie des poils chez tous les animaux, sauf chez l’homme, où elle leur est salutaire, comme elle l’est à tout le corps.. Le bon est quelque chose de si varié et de si divers que, même dans le corps de l’homme, l’huile n’est bonne que pour l’usage externe, et qu’elle est très mauvaise pour l’usage interne. Voilà pourquoi tous les médecins interdisent aux malades l’usage de l’huile ; ils ne leur en laissent absorber qu’à très petite dose, juste assez pour chasser l’impression désagréable que font les aliments et les viandes sur le sens de l’odorat. »



























